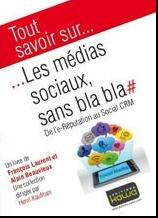07/05/2006
Prix, vous avez dit prix ?
 Propos recueillis par Anika Michalowska.
Propos recueillis par Anika Michalowska. Des études et modèles statistiques pour déterminer le prix idéal des biens technologiques, comme il en existe pour les produits de consommation courante ? Admirable, bien que quelque peu illusoire ! Mais plutôt que de se morfondre ici sur les échecs passés, rappelons plutôt quelques évidences caractéristiques des biens high tech.
Avec la première d’entre toutes : leur vertigineuse chute des prix. Ainsi les écrans LCD 16/9 de 17 pouces, qui à l'automne 2003 se vendaient en France plus de 1 000 €, en valaient-ils à peine 800 un an plus tard, soit une chute de 20%. Chute qui n'est certainement pas près de s'arrêter au vu des gigantesques capacités de production asiatiques.
Souvenons-nous également qu'un lecteur DVD qui coûte en moyenne 100 € aujourd’hui – voire 40€ en hyper –, se payait 850€ en 1998, et encore près de 400€ en 2000 ! On se situerait donc plus ici au niveau du pilotage à vue en pleine tempête : le temps de réaliser une telle étude et d’en modéliser les résultats… elle sera depuis longtemps périmée.
Ne sauraient donc être réellement concernés par quelque tentative de modélisation que les produits pour lesquels la concurrence demeure balbutiante : les innovations de rupture, au demeurant fort rares.
Innovations qui demeureront encore des mois après leur lancement totalement incompréhensibles aux consommateurs non avertis, voire même à tous consommateurs – à l'exception de ces aficionados que sont les early adopters. La grande majorité des Français se révèle aujourd’hui totalement incapables d’imaginer l’usage qu’ils pourraient faire de produits réellement innovants, et totalement différents ce ceux qui peuplent leur quotidien.
Prenez les enregistreurs vidéo à disque dur qui commencent à pénétrer le marché : même si tout le monde sait à quoi sert un disque dur dans un ordinateur, bien peu de gens l’an passé étaient capables d’imaginer comment utiliser le même disque dur logé dans un petit boîtier près de leur téléviseur, à la place de leur bon vieux magnétoscope. Seule solution pour le chercheur : équiper une population cible de prototypes. Ce qui va bien en quali, mais devient plus problématique en quanti. Or les modèles sont gourmands en chiffres.
On sera alors tenté d’extrapoler à partir d’information recueillie auprès de la seule population des early adopters, ces fous de high tech à l’affût de toute nouveauté. Ce qui hier marchait encore à peu près, quand le high tech était encore très aspirationnel ; mais aujourd’hui la situation s’est hélas encore un peu plus compliquée.
Au lancement de toute innovation, on distingue schématiquement trois cibles : ces fameux early adopters qui se ruent dessus et constituent un réservoir de 2 à 300 000 individus à l’échelle du continent ; les immediate followers, qui prennent aussitôt le relais et en assurent le succès, avant que les populations mainstream s’y intéressent… mais les prix auront alors très sévèrement chuté.
Le comportement des early adopters importe en fait relativement peu : ils se gavent continuellement d’innovations, et leur intérêt pour un produit particulier ne préjuge en aucun cas de son succès ultérieur ; celui des immediate followers apparaît en revanche capital : ce sont eux qui lui confèrent sa légitimité, lui assurant une réelle assise. Un bien high tech dont ils ne se saisissent pas demeurera une curiosité, au mieux ancrée sur un marché de niche.
Le problème ces dernières années est celui d’un croissant découplage entre early adopters et immediate followers, ces derniers adoptant des comportements de plus en plus proches des populations mainstream : dès lors, où mettre le curseur en matière de prix ?
En fait, le marché s’en charge fort bien tout seul. Les industriels lanceront toujours leurs innovations au prix le plus élevé, ne serait-ce que dans l’espoir fragile d’amortir le plus rapidement possible leurs coûts de R&D ; et ils auraient bien tort de s’en priver, l’élasticité au prix se révélant très faible auprès des early adopters.
Et après ? Après, ce sera la vertigineuse chute des prix, liée aux gigantesques capacités de production en matière d’écrans, aux faibles coûts de production asiatiques, … et à l’attentisme de consommateurs de plus en plus blasés. Besoin de modèles sophistiqués ? Pas vraiment : simplement de bon sens. Et des nerfs solides.
Marketing Magazine N°92 – Janvier 2005
19:39 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
05/05/2006
La communication en synapse : vers un citoyen ni global, ni local.
 La globalisation du consommateur peut s’envisager d’un point de vue purement mécanique : pour des économies d’échelle évidentes, les produits deviennent mondiaux, et par voie de fait les citoyens achètent les mêmes écrans LCD au Japon, en France ou au Mexique, mangent les mêmes hamburgers à Paris, Séoul ou New-York ; et dans toutes les rues du monde, ils téléphonent avec les mêmes appareils fabriqués en Corée ou en Chine.
La globalisation du consommateur peut s’envisager d’un point de vue purement mécanique : pour des économies d’échelle évidentes, les produits deviennent mondiaux, et par voie de fait les citoyens achètent les mêmes écrans LCD au Japon, en France ou au Mexique, mangent les mêmes hamburgers à Paris, Séoul ou New-York ; et dans toutes les rues du monde, ils téléphonent avec les mêmes appareils fabriqués en Corée ou en Chine. Pourtant, là ne résident toujours pas les clefs du succès : Mac Donald en France a dû compléter ses menus de salades, mieux adaptées aux goûts hexagonaux. Plus récemment, les opérateurs de la téléphonie mobile ont découverts que les usages fondaient plus l’innovation que les technologies elles-mêmes, d’où l’échec du WAP en France, versus l’insolent développement de l’i.Mode au Japon : si les produits s’internationalisent rapidement, il n’en va pas de même des usages.
Autre vecteur très souvent avancé de la globalisation de notre société : les marques. Sans même approfondir le rejet théorique et éthique tels qu’ils émergent de plus en plus, et parfois violemment, tant dans les démarches des groupes d’opposants à la publicité ou dans No Logo*, nous ne pouvons que constater l’immense reflux des marques dans des secteurs aussi divers que le high tech ou l’alimentaire, où non maques et produits premier prix grignotent inlassablement les parts de marchés des marques leaders.
Dernier vecteur que nous envisagerons – sans recherche d’exhaustivité –, les réseaux de communication, et au premier rang d’entre eux, Internet : force est de reconnaître que si ces derniers n’ont – et ne sauraient avoir – d’existence que mondiale, leur utilisation ne milite pas nécessairement dans le sens d’une globalisation de la consommation. Nike notamment en a fait ces dernières années la cuisante expérience, passant de sa position de marque statutaire des jeunes à celle de punching ball, après son interpellation quant à son emploi d’enfants chinois.
Il semblerait donc que notre société – ou du moins les jeunes générations – s’oriente plus vers une globalisation du rejet, sinon du global, du moins du globalisateur. Pour comprendre ce reflux « vécu » du mondial par rapport à sa réalité concrète – nul ne saurait remettre en cause un tel état de fait –, il convient de se pencher sur les modes organisationnels de nos sociétés en matière de communications interpersonnelles.
Une des analyses les plus pertinentes pour expliquer à la fois la structure des sociétés occidentales du siècle dernier et l’explosion d’Internet, est celle de l’école de Palo Alto**. Pour Paul Watzlawick et ses confrères, nous interagissons tous au sein de plusieurs systèmes relationnels régis par les quatre principes de totalité, rétroaction, homéostasie et équifinalité ; ces systèmes sont qualifiés d’ouverts en ce sens nous naviguons sans cesse d’un système à un autre : notre famille, nos amis, notre travail, etc.
C’est essentiellement l’urbanisation qui a permis le développement d’une telle organisation sociétale : les villageois de la fin du dix-neuvième siècle vivaient en des systèmes quasiment fermés. Dans un village, tout ce sait, toute action individuelle influe sur, et est influencée par, la communauté : soit on accepte les codes rigides, soit on s’en exclue, sans aucune solution intermédiaire.
La ville constitue le lieu idéal de développement des systèmes ouverts : contrairement au village, espaces de travail, de loisirs, de vie, etc., peuvent se déconnecter les uns des autres, et chaque individu peut évoluer librement de l’un à l’autre ; il peut même changer de personnalité de l’un à l’autre : méthodique au travail, convivial entre amis, autoritaire avec les siens, etc. Les moyens traditionnels de communication – voiture, métro – et de télécommunication – téléphone – ont ensuite favorisé la mutation.
Internet dilate les groupes à l’extrême, certains n’existant même que dans la virtualité : forums, chats. Sans nécessairement conduire au syndrome des personnalités multiples ou à la schizophrénie, l’anonymat autorise l’adaptation souple des citoyens aux communautés au sein desquelles ils s’inscrivent au gré de leurs choix.
Mais aujourd’hui, apparaissent de nouveaux modes de communication qui remettent totalement en cause l’analyse de Palo Alto : des systèmes non plus seulement ouverts, mais totalement déstructurés ne répondant plus aux quatre principes de totalité, rétroaction, homéostasie et équifinalité.
Dans un système ouvert, tout comme dans un système fermé, les participants respectent un certain nombre de règles précises, qui déterminent en fait leur appartenance à un groupe social particulier : si dans un système fermé, elles apparaissent totalement incontournables – puisqu’il n’existe aucune solution hors du groupe –, au contraire dans un système ouvert, leur observation se révèle souvent plus souple, l’exclusion du groupe ne constituant plus un danger si élevé.
Les blogs journalistiques ne diffèrent pas réellement du modèle, ne serait-ce que parce qu’y demeure un certain contrôle. Ce qui n’est plus nécessairement le cas des trois millions de blogs d’adolescents qui se sont récemment développés sur le site de Skyrock en France : les contours en sont flous – tout inconnu peut s’inviter au sein de ce qui ressemble pourtant plus à cercle privé qu’à un site institutionnalisé, ou du moins simplement public.
Aujourd’hui, parmi les jeunes Européens, se développent deux systèmes relationnels totalement opposés. Essentiellement dans les banlieues des grandes conurbations, se renforcent des tribus au fonctionnement assez proche de celui des villages, où chacun cherche à rester en étroit contact avec les autres membres de son groupe : d’où ces jeunes qui se téléphonent d’une salle à l’autre des complexes cinématographiques pour commenter les films qu’ils regardent et inviter leurs amis à les rejoindre.
Pour ces jeunes, les marques jouent un grand rôle identitaire, définissant l’appartenance à son clan, et des leaders comme Lacoste ont souffert de devenir l’emblème de certains d’entre eux ; d’où le succès plus récent de Com8, la marque de Joey Starr. Pour eux, par contre, la mondialisation ne constitue qu’une donnée abstraite et lointaine, tout au plus une contrainte économique qui les rejette dans le chômage, et les referment sur leur tribu.
Inversement, la grande majorité des jeunes – et notamment tous ceux qui maîtrisent parfaitement les nouveaux outils de communication – cassent les systèmes relationnels actuels, pour développer des organisations totalement déstructurées : ici, le groupe devient filandreux, s’organise autour de chaque individu comme les neurones déploient leurs synapses ; et sur le même modèle, les relations qui s’établissent peuvent se renforcer ou s’amoindrir au fil du temps, sans réelles conséquences.
Pouvons-nous pour autant parler de comportement de citoyen mondial dans ce dernier cas ? En fait, il ne semble pas quelque spatialisation joue ici : les encyclopédies Wiki étendent leur ramifications aux quatre coins de la planète tandis que les blogs ne dépassent pas nécessairement les limites d’un quartier, mais dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit que du prolongement de mon système relationnel personnel, sans plus ; et si l’espace ne constitue plus une contrainte, il apparaît plutôt comme un paramètre secondaire.
Pour passer enfin du citoyen au consommateur, il convient de s’interroger sur la notion fondamentale de marque : or cette dernière ne joue plus aucun rôle identitaire dans un système ultra-ouvert et déstructuré, puisque plus personne ne revendique son appartenance à quelque groupe que ce soit. Et ce tant dans le monde virtuel d’Internet que dans le concret des cours de lycée : les grandes marques mondiales laissent peu à peu la place à d’autres, moins connues, voire disparaissent totalement face à l’anonymat d’un jean acheté aux puces !
* Naomi Klein, No logo - La tyrannie des marques, J'ai Lu, 2004.
** Paul Watzlawick et al., Une logique de la communication, Seuil Points Essais.
07:10 Publié dans Consumer Insight | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/05/2006
Worldwide Consumer Insight
 Le prochain challenge du Consumer Insight, c’est l’international.
Le prochain challenge du Consumer Insight, c’est l’international.
Dans un même pays, le Consumer Insight, c’est la démarche originale qui consiste à considérer les individus dans leur globalité, et non comme simples consommateurs de lessive ou de voitures de sport.
A l’international, le Consumer Insight, c’est à la fois la seule manière de comprendre pourquoi un produit fonctionne dans un pays et pas dans un autre ; et sous quelles conditions on peut transférer un produit innovant – ou non d’ailleurs – d’un pays à un autre.
Considérer donc les habitants de chaque pays, non pas comme simples consommateurs de burgers ou de chaînes hifi, mais dans leur totalité de citoyens – avec tout le poids d’une histoire, d’une culture, d’un inconscient collectif spécifiques, qui vont donner tout leur sens à cette réalité.
Prenons l’exemple de la téléphonie : tous les teenagers de par le monde entier – enfin dans les pays développés – se baladent avec des téléphones leur permettant de prendre et d’envoyer des photos, voire de surfer sur le Net ou plus. Et pourtant ce ne sont certainement pas les mêmes appareils – du moins en termes d’usage.
Car si les adolescents français aiment bien prendre une photo de ci, de là, ils se gardent bien de les envoyer ainsi : ils n’y voient qu’un petit jeu, bien sympathique – une simple collection de souvenirs spontanés et éphémères.
La téléphonie mobile leur permet, même à domicile, une communication phatique – à la limite souvent de la communication : trois ou quatre lignes de texto. Ce n’est que lorsque leur nomadisme les conduit loin de chez eux, que le mobile retrouve une fonctionnalité de communication interpersonnelle pleine et entière : je fixe rendez-vous à des amis, j’essaie de les retrouver au hasard de mes pérégrinations.
Cette usage « minimal » se complète au Japon de fonctionnalités plus personnelles : recevoir des mails, commander des produits – en fait, le mobile devient le bureau ambulant du nomade suprême : celui qui vit plus dans la rue qu’à son domicile.
Notre société paraîtrait bien sédentaire à ces jeunes gens qui ne rentrent chez eux que pour dormir, très tard ; à ces hommes qui remplacent dans leur déambulations leurs épouses par des hôtesses de bar – une tradition plus que séculaire, il suffit d’écouter Kafu nous raconter dans Tsuyu no atosaki* l’histoire de Kimie, barmaid à Ginza… en 1931!
Deux téléphonies mobiles, totalement divergentes, bien que reposant sur les mêmes terminaux – et si éloignées également de celle des jeunes Chinois, même si sous certains aspects, leur nomadisme les rapproche des Japonais.
Mais le mobile chinois, c’est avant tout l’objet statutaire qui distingue son propriétaire, jusque dans ces appareils plaqués or et incrustés de pierres précieuses ! Ce qui n’empêche pas l’extrême utilité d’un produit polyvalent dans un pays où les infrastructures en téléphonie fixe demeurent insuffisantes.
Rien d’étonnant alors que la télévision sur mobile trouve naturellement sa place au Pays du Soleil Levant – et qu’en France, 70% des cobayes testés par Bouygues Telecom se soient contenté d’utiliser leur superbe combine Sagem My Mobile TV …le soir, à domicile. Voir page Actualité du 1 Avril 2006 : Quand regarderez-vous la télévision sur votre téléphone mobile ?
A l’international, le Consumer Insight permet de mieux cerner la réalité des produits, au travers de la personnalité des citoyens qui les utilisent ; c’est aussi la seule voie pour valider la transposition d’un concept d’un pays à l’autre : la télévision sur mobile s’adaptera très aisément de Tokyo à Pékin – en changeant évidemment de sens : les jeunes Chinois seront en représentation sociale là où les Japonais étaient en simple enrichissement de leur quotidien. Par contre, le succès semble moins au rendez-vous à Paris.
Autre exemple : celui des blogs qui, en traversant l’Atlantique, se sont considérablement transformés. Essentiellement journalistiques et politiques, les premiers blogs américains constituaient l’opportuniste réaction d’un certain nombre de penseurs démocrates à l’omniprésence de l’administration républicaine dans les médias, Fox News en tête.
Et bien évidemment, journalistiques et hommes politiques français rédigent tous aujourd’hui leur blog, de gauche comme de droite : un intellectuel français ne saurait exister sans ; mais ce ne sont pas eux qui ont le plus contribué au succès du phénomène dans notre pays : l’objet s’est adapté à notre univers en se chargeant de fonctionnalités nouvelles.
Le blog, tout comme le SMS, est devenu le moyen de communication fétiche des teenagers, parce qu’il leur permet de tisser une trame relationnelle totalement informelle – libre de toutes contraintes : pas besoin de compétences informatiques particulières ; et surtout, tout le monde peut s’inviter, sans droit, ni obligation : un peu comme bouteille à la mer dont chacun peut se saisir ou laisser couler.
Potentiellement, de tels blogs peuvent aller très loin ; effectivement, ils ne dépassent guère les limites du quartier, avec de vagues ramifications filandreuses… et c’est parfait pour les adolescents qui les animent.
Mais le blog s’est également rapidement révélé l’outil relationnel local par excellence : ete34 est « le 1er portail internet dédié exclusivement au baby-sitting et au soutien scolaire dans l'Hérault ; ou allez vous promener sur : Les nouveaux blogs du Rond de Sorcières pour apprendre « à tricoter votre premier châle en dentelle » ! Cliquez sur Plus sur la page d’accueil de Google et surfez de blogs en blogs : vous serez étonnés !
Vous découvrirez comment les technologies de pointe s’adaptent au bon goût des terroirs et vous redécouvrirez de nouvelles cultures, de nouvelles pratiques, si proches en apparence, et parfois si lointaines.
Ce faisant, vous prendrez un bon bain de Consumer Insight. Et vous réalisez que la traque aux signaux faibles peut également s’effectuer en sautant de blog en blog, au gré des inspirations : ça aussi, c’est la posture Consumer Insight…
* Kafu: Tsuyu no atosaki, Hisamitsu Nagai, 1931
13:21 Publié dans Consumer Insight | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
01/05/2006
Explicite, implicite… et après ?
 Bien souvent lorsque lors de divers colloques, publicitaires et cogniticiens échangent sur l’inconscient, le courant passe mal et l’on assiste comme à un dialogue de sourds : normal, ils ne traitent pas du même objet !
Bien souvent lorsque lors de divers colloques, publicitaires et cogniticiens échangent sur l’inconscient, le courant passe mal et l’on assiste comme à un dialogue de sourds : normal, ils ne traitent pas du même objet !
Quand les études marketing traitent de l’inconscient, il s’agit toujours d’un inconscient Freudien, cristallisant pulsions et refoulements – alors que l’inconscient cognitif se résume un mode de traitement de l’information : explicite – donc conscient – versus implicite – donc inconscient.
Difficile de se comprendre alors !
L’inconscient Freudien apparaît riche de fantasmes et de pulsions – mais également d’explications : telle publicité dérange parce que trop sexuellement connotée ; telle appareil rebute, parce d’une inavouable complexité ; etc. Surtout l’inconscient Freudien laisse émerger, à qui sait y faire, d’immenses bouffées de sens, sur lesquelles se fonde… une bonne part du marketing et de la communication modernes, à la suite de Dichter et Joannis.
L’inconscient cognitif demeure froid : c’est celui d’une machine extrêmement complexe – bien plus qu’un simple ordinateur – mais d’une machine malgré tout : notre cerveau. L’inconscient cognitif ne laisse rien émerger – sinon des variations de courant électrique qu’enregistreront les électroencéphalographes !
Si notre inconscient cognitif reste désespérément muet, les cogniticiens ont malgré tout inventé des protocoles pour le « faire parler », comme la technique dite de l’amorçage, qui consiste à préactiver des champs lexicaux.
Concrètement on fait défiler des images sur un écran en demandant au patient de nommer à chaque fois l’objet présenté et on mesure avec précision leur temps de réponse ; et lorsque le champ sémantique d’un objet a déjà été activé par le précédent, la réponse est plus rapide : ainsi le mot médecin est plus rapidement prononcé si sa photo suit celle d’une infirmière qu’une porte de garage. Et l’on conclut évidemment que médecin et infirmière appartiennent au même champ sémantique.
C’est une méthodologie semblable qu’utilisa Gerald Zaïtman de l’Harvard Business School au cours d’une étude destinée à évaluer les traits les plus saillants de Coca Cola face à une eau minérale. Les sujets de l'expérience, assis face à un écran d’ordinateur, devaient réagir le plus rapidement possible à l’apparition de lettres, en citant des mots tels que heureux, propre, naturel, vital, tous issus de catégories sémantiques prédéfinies. Enfin, des images de Coca Cola ou d’eau minérale précédaient l’inscription des lettres à l’écran.
Gerald Zaïtman espérait ainsi accéder à l’image implicite de Coca Cola, les traits appartenant au champ sémantique de la marque devant nécessairement être prononcés plus rapidement que les autres – parce qu’amorcés par cette dernière. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que, pour les hommes essentiellement, elle se chargeait notamment de deux traits totalement ignorés jusqu’alors : naturel et mystérieux.
Pourquoi donc les américains jugent-ils le Coca Cola plus naturel que l’eau minérale ? Bien difficile de l’expliquer… puisque nous nous situons ici dans le champ du non explicite ! En qualitatif traditionnel, une fois passées les barrières de l’inconscient – une fois le matériau porté à la conscience des interviewés – il devient aisé de s’en saisir et de leur demander de le préciser et l’expliciter – d’ailleurs, tout test projectif demande à être immédiatement approfondi par les personnes concernées.
Mais ici ? Nous nous situons dans le champ, non du difficilement exprimable, mais du totalement inexprimable. Alors Zaïtman et ses collaborateurs pourront bien nous expliquer que certainement ses compatriotes ont pris l’habitude de boire des cannettes de Coca Cola sur la plage, ou du moins en plein air, ce ne sont que supputations.
En d’autres termes, si l’inconscient cognitif constitue pour le marketing et la publicité un champ d’investigation prometteur, les premiers résultats n’apparaissent pas totalement convaincants : autant les connaissances que nous délivrent les neurosciences concernant le fonctionnement du cerveau humain se révèlent enrichissantes, autant de trop rapides transferts méthodologiques semblent devoir aboutir à une impasse.
21:04 Publié dans Sciences Cognitives | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
30/04/2006
Aux origines des Sciences Cognitives
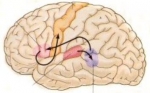 En plein dix-neuvième siècle, le médecin français Broca hérite d’un étrange patient, Monsieur « Tan-Tan », ainsi nommé parce que s’il comprend le sens des mots, il ne peut répéter qu'une seule syllabe « Tan » agrémentée de « Sacré nom de Dieu ».
En plein dix-neuvième siècle, le médecin français Broca hérite d’un étrange patient, Monsieur « Tan-Tan », ainsi nommé parce que s’il comprend le sens des mots, il ne peut répéter qu'une seule syllabe « Tan » agrémentée de « Sacré nom de Dieu ».
A sa mort en 1861, Broca dissèque son cerveau et y découvre une importante lésion au niveau du lobe frontal, entre le sourcil et la tempe gauche : là doit se situer le centre du langage – maintenant appelé aire de Broca –, dont la détérioration provoque une aphasie motrice : le malade parle un charabia incompréhensible, tout en comprenant parfaitement ce qui lui est dit.
La découverte fonde notre vision moderne du cerveau humain, en établissant que ce dernier se compose de centres spécialisés, que l’on peut identifier.
Une vingtaine d’années plus tard, Carl Wernicke procède à l’autopsie d’un autre malade, de son vivant tant incapable de comprendre le sens des mots que d’énoncer des phrases pleines de sens, se contentant d’assertions du type : « Boutique à manger rue sur un chandelier de cuivre ou bien ». Une seconde zone, temporo-pariétale, également impliquée dans le langage, est identifiée à laquelle il donnera son nom.
Au fil des ans se dessinera une cartographie complète du cerveau, que les techniques modernes vont régulièrement permettre d’affiner, de l’électroencéphalographie à l’imagerie par résonance magnétique ou la tomographie par émission de positons – où l’on injecte de l’oxygène 15O qui émet des positons pour localiser les zones actives du cerveau au moment d’un test : quand le patient parle, lit, effectue des opérations de calcul mental, etc.
Va-t-on enfin pouvoir localiser où et comment notre cerveau traite, puis stocke les informations qu’il recueille ? Oui et non. Oui, puisque l’on commence à suivre quasiment à la trace les flux qui y transitent ; et non, parce mémoire et mémorisation impliquent un nombre extrêmement important de zones différentes, qui interagissent en totale continuité, au travers de multiples traitements parallèles.
Les informations qui arrivant au cerveau transitent par une zone un peu secrète, cachée sous la cinquième circonvolution temporale, à cheval sur les deux hémisphères : l’hippocampe. Cette aire est aujourd’hui considérée comme le siège de la mémoire à court terme : un patient à qui on la retire se révélera incapable de construire de nouveaux souvenirs, tout en conservant intacts ceux antérieurs à cette ablation.
L’hippocampe ne constitue pas à proprement parler le lieu de stockage de la mémoire à court terme : avec les zones voisines, il constituerait une sorte de carrefour, non seulement espace de triage des informations parvenant au cerveau, mais également coordonnateur de leur interprétation responsable de la constitution des souvenirs, avant leur enregistrement au sein de la mémoire à long terme.
Car ce qui parvient au cerveau, ce ne sont que des informations parcellaires, inorganisées. Pour vos dix-huit ans, vos parents ont organisé une magnifique fête surprise, tous vos amis étaient réunis sans que vous n’ayez eu vent de l’opération : des années plus tard, vous en conservez un souvenir ému, truffé d’images intactes. Et pourtant, tout cela ne s’est pas imprimé tel quel au plus profond de vos neurones.
Votre amie vous sourit tendrement, cachant maladroitement un cadeau derrière son dos : mais ce n’est pas ce que vous avez perçu. Ce qui est arrivé par votre nerf optique jusqu’à l’hippocampe, ce ne sont même pas des couleurs et des formes, mais des fréquences, des influx électriques, des informations brutes qui devront être comparées à d’autres, stockées dans différentes parties du cortex ; pour les seules couleurs, un centre en gouverne les concepts, un autre la sémantique, un troisième assurant la médiation entre les deux premiers : sans cela, impossible d’évoquer la robe rouge de votre compagne !
Formes, reliefs, contours, tout fait l’objet de multiples traitements parallèles ; et quand vous aurez réalisé que ce qui bouge en face de vous, c’est un être humain, d’autres opérations vous apprendront que ce personnage, c’est votre petite amie… petite amie que vous avez instantanément reconnue pourtant. Ce qu’il faut bien réaliser, c’est que le cerveau ne travaille pas en séquences, du type perception puis interprétation : l’interprétation est en fait constitutive de la perception.
Il n’est pas de perception sans interprétation – puis reconstruction. La meilleure preuve en est que si vous fermez un œil, non seulement vous continuez à percevoir le monde en relief, mais également dans son intégralité, sans un trou noir au beau milieu ! Pourtant votre œil est dépourvu de cellules visuelles là où s’y raccorde le nerf optique : pour cette partie de la rétine, aucune information ne parvient au cerveau – mais comme nous avons deux yeux, ce n’est pas grave, l’œil droit fournissant les données manquant au gauche et vice versa.
Si vous fermez un œil… rien ne se passe, aucun trou noir ne vient perturber notre vision, tout au plus un objet pourra-t-il inopportunément disparaître : pourquoi ? Parce que notre cerveau reconstitue l’information manquante, à l’aide de l’information périphérique : s’il y a un mur en béton à gauche et à droite du trou noir, il y incruste du béton. Evidemment, s’il y a un petit tableau suspendu à cet endroit précis, il sera bien en peine de l’y placer.
Ce point aveugle porte le nom de zone de Mariotte ; une expérience aisée à réaliser vous permettra de « percevoir » la vôtre – évidemment le terme de percevoir est impropre. Fermez votre œil gauche en fixant attentivement la croix du tableau ci-dessous, puis rapprochez-vous de la page ; à une distance d’environ 30 cm, le rond va disparaître, pour ensuite réapparaître (imprimez la page, le scintillement de l’écran peut perturber l’expérience).

Vous avez certainement fait, un jour ou l’autre, la désagréable expérience de la personne qui vient à vous tout sourire… et que vous ne reconnaissez pas ! Et pourtant, l’instant d’après, quand elle a décliné son identité, vous ne pouvez que rougir de confusion et vous confondre en excuses : mais comment donc avez-vous pu commettre un tel impair ?
Tout simplement parce votre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur, il ne compare pas un à un chaque visage rencontré à tous ceux précédemment enregistrés dans sa base de données : toutes les faces déjà rencontrées sont liées à d’autres souvenirs, d’autres contextes : un professeur à l’école où il enseigne, un collègue de bureau à la société où vous travaillez ; bien sûr, vos amis les plus proches participeront d’un nombre élevé d’environnements contextuels.
De fait, quand vous pénétrez dans l’immeuble qui abrite la société où vous travaillez, tous les visages liés à ce contexte seront plus aisément disponibles que ceux corrélés à l’université, où vous avez passé certes de longs mois, mais que vous avez quittée il y a maintenant deux ans. Et de fait, vous risquez de passer à côté d’un de vos anciens professeurs sortant du bureau de votre directeur sans même le reconnaître.
12:55 Publié dans Sciences Cognitives | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |