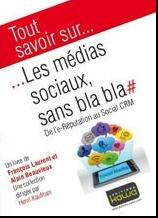01/05/2006
Explicite, implicite… et après ?
 Bien souvent lorsque lors de divers colloques, publicitaires et cogniticiens échangent sur l’inconscient, le courant passe mal et l’on assiste comme à un dialogue de sourds : normal, ils ne traitent pas du même objet !
Bien souvent lorsque lors de divers colloques, publicitaires et cogniticiens échangent sur l’inconscient, le courant passe mal et l’on assiste comme à un dialogue de sourds : normal, ils ne traitent pas du même objet !
Quand les études marketing traitent de l’inconscient, il s’agit toujours d’un inconscient Freudien, cristallisant pulsions et refoulements – alors que l’inconscient cognitif se résume un mode de traitement de l’information : explicite – donc conscient – versus implicite – donc inconscient.
Difficile de se comprendre alors !
L’inconscient Freudien apparaît riche de fantasmes et de pulsions – mais également d’explications : telle publicité dérange parce que trop sexuellement connotée ; telle appareil rebute, parce d’une inavouable complexité ; etc. Surtout l’inconscient Freudien laisse émerger, à qui sait y faire, d’immenses bouffées de sens, sur lesquelles se fonde… une bonne part du marketing et de la communication modernes, à la suite de Dichter et Joannis.
L’inconscient cognitif demeure froid : c’est celui d’une machine extrêmement complexe – bien plus qu’un simple ordinateur – mais d’une machine malgré tout : notre cerveau. L’inconscient cognitif ne laisse rien émerger – sinon des variations de courant électrique qu’enregistreront les électroencéphalographes !
Si notre inconscient cognitif reste désespérément muet, les cogniticiens ont malgré tout inventé des protocoles pour le « faire parler », comme la technique dite de l’amorçage, qui consiste à préactiver des champs lexicaux.
Concrètement on fait défiler des images sur un écran en demandant au patient de nommer à chaque fois l’objet présenté et on mesure avec précision leur temps de réponse ; et lorsque le champ sémantique d’un objet a déjà été activé par le précédent, la réponse est plus rapide : ainsi le mot médecin est plus rapidement prononcé si sa photo suit celle d’une infirmière qu’une porte de garage. Et l’on conclut évidemment que médecin et infirmière appartiennent au même champ sémantique.
C’est une méthodologie semblable qu’utilisa Gerald Zaïtman de l’Harvard Business School au cours d’une étude destinée à évaluer les traits les plus saillants de Coca Cola face à une eau minérale. Les sujets de l'expérience, assis face à un écran d’ordinateur, devaient réagir le plus rapidement possible à l’apparition de lettres, en citant des mots tels que heureux, propre, naturel, vital, tous issus de catégories sémantiques prédéfinies. Enfin, des images de Coca Cola ou d’eau minérale précédaient l’inscription des lettres à l’écran.
Gerald Zaïtman espérait ainsi accéder à l’image implicite de Coca Cola, les traits appartenant au champ sémantique de la marque devant nécessairement être prononcés plus rapidement que les autres – parce qu’amorcés par cette dernière. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que, pour les hommes essentiellement, elle se chargeait notamment de deux traits totalement ignorés jusqu’alors : naturel et mystérieux.
Pourquoi donc les américains jugent-ils le Coca Cola plus naturel que l’eau minérale ? Bien difficile de l’expliquer… puisque nous nous situons ici dans le champ du non explicite ! En qualitatif traditionnel, une fois passées les barrières de l’inconscient – une fois le matériau porté à la conscience des interviewés – il devient aisé de s’en saisir et de leur demander de le préciser et l’expliciter – d’ailleurs, tout test projectif demande à être immédiatement approfondi par les personnes concernées.
Mais ici ? Nous nous situons dans le champ, non du difficilement exprimable, mais du totalement inexprimable. Alors Zaïtman et ses collaborateurs pourront bien nous expliquer que certainement ses compatriotes ont pris l’habitude de boire des cannettes de Coca Cola sur la plage, ou du moins en plein air, ce ne sont que supputations.
En d’autres termes, si l’inconscient cognitif constitue pour le marketing et la publicité un champ d’investigation prometteur, les premiers résultats n’apparaissent pas totalement convaincants : autant les connaissances que nous délivrent les neurosciences concernant le fonctionnement du cerveau humain se révèlent enrichissantes, autant de trop rapides transferts méthodologiques semblent devoir aboutir à une impasse.
21:04 Publié dans Sciences Cognitives | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
30/04/2006
Aux origines des Sciences Cognitives
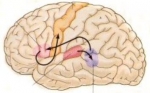 En plein dix-neuvième siècle, le médecin français Broca hérite d’un étrange patient, Monsieur « Tan-Tan », ainsi nommé parce que s’il comprend le sens des mots, il ne peut répéter qu'une seule syllabe « Tan » agrémentée de « Sacré nom de Dieu ».
En plein dix-neuvième siècle, le médecin français Broca hérite d’un étrange patient, Monsieur « Tan-Tan », ainsi nommé parce que s’il comprend le sens des mots, il ne peut répéter qu'une seule syllabe « Tan » agrémentée de « Sacré nom de Dieu ».
A sa mort en 1861, Broca dissèque son cerveau et y découvre une importante lésion au niveau du lobe frontal, entre le sourcil et la tempe gauche : là doit se situer le centre du langage – maintenant appelé aire de Broca –, dont la détérioration provoque une aphasie motrice : le malade parle un charabia incompréhensible, tout en comprenant parfaitement ce qui lui est dit.
La découverte fonde notre vision moderne du cerveau humain, en établissant que ce dernier se compose de centres spécialisés, que l’on peut identifier.
Une vingtaine d’années plus tard, Carl Wernicke procède à l’autopsie d’un autre malade, de son vivant tant incapable de comprendre le sens des mots que d’énoncer des phrases pleines de sens, se contentant d’assertions du type : « Boutique à manger rue sur un chandelier de cuivre ou bien ». Une seconde zone, temporo-pariétale, également impliquée dans le langage, est identifiée à laquelle il donnera son nom.
Au fil des ans se dessinera une cartographie complète du cerveau, que les techniques modernes vont régulièrement permettre d’affiner, de l’électroencéphalographie à l’imagerie par résonance magnétique ou la tomographie par émission de positons – où l’on injecte de l’oxygène 15O qui émet des positons pour localiser les zones actives du cerveau au moment d’un test : quand le patient parle, lit, effectue des opérations de calcul mental, etc.
Va-t-on enfin pouvoir localiser où et comment notre cerveau traite, puis stocke les informations qu’il recueille ? Oui et non. Oui, puisque l’on commence à suivre quasiment à la trace les flux qui y transitent ; et non, parce mémoire et mémorisation impliquent un nombre extrêmement important de zones différentes, qui interagissent en totale continuité, au travers de multiples traitements parallèles.
Les informations qui arrivant au cerveau transitent par une zone un peu secrète, cachée sous la cinquième circonvolution temporale, à cheval sur les deux hémisphères : l’hippocampe. Cette aire est aujourd’hui considérée comme le siège de la mémoire à court terme : un patient à qui on la retire se révélera incapable de construire de nouveaux souvenirs, tout en conservant intacts ceux antérieurs à cette ablation.
L’hippocampe ne constitue pas à proprement parler le lieu de stockage de la mémoire à court terme : avec les zones voisines, il constituerait une sorte de carrefour, non seulement espace de triage des informations parvenant au cerveau, mais également coordonnateur de leur interprétation responsable de la constitution des souvenirs, avant leur enregistrement au sein de la mémoire à long terme.
Car ce qui parvient au cerveau, ce ne sont que des informations parcellaires, inorganisées. Pour vos dix-huit ans, vos parents ont organisé une magnifique fête surprise, tous vos amis étaient réunis sans que vous n’ayez eu vent de l’opération : des années plus tard, vous en conservez un souvenir ému, truffé d’images intactes. Et pourtant, tout cela ne s’est pas imprimé tel quel au plus profond de vos neurones.
Votre amie vous sourit tendrement, cachant maladroitement un cadeau derrière son dos : mais ce n’est pas ce que vous avez perçu. Ce qui est arrivé par votre nerf optique jusqu’à l’hippocampe, ce ne sont même pas des couleurs et des formes, mais des fréquences, des influx électriques, des informations brutes qui devront être comparées à d’autres, stockées dans différentes parties du cortex ; pour les seules couleurs, un centre en gouverne les concepts, un autre la sémantique, un troisième assurant la médiation entre les deux premiers : sans cela, impossible d’évoquer la robe rouge de votre compagne !
Formes, reliefs, contours, tout fait l’objet de multiples traitements parallèles ; et quand vous aurez réalisé que ce qui bouge en face de vous, c’est un être humain, d’autres opérations vous apprendront que ce personnage, c’est votre petite amie… petite amie que vous avez instantanément reconnue pourtant. Ce qu’il faut bien réaliser, c’est que le cerveau ne travaille pas en séquences, du type perception puis interprétation : l’interprétation est en fait constitutive de la perception.
Il n’est pas de perception sans interprétation – puis reconstruction. La meilleure preuve en est que si vous fermez un œil, non seulement vous continuez à percevoir le monde en relief, mais également dans son intégralité, sans un trou noir au beau milieu ! Pourtant votre œil est dépourvu de cellules visuelles là où s’y raccorde le nerf optique : pour cette partie de la rétine, aucune information ne parvient au cerveau – mais comme nous avons deux yeux, ce n’est pas grave, l’œil droit fournissant les données manquant au gauche et vice versa.
Si vous fermez un œil… rien ne se passe, aucun trou noir ne vient perturber notre vision, tout au plus un objet pourra-t-il inopportunément disparaître : pourquoi ? Parce que notre cerveau reconstitue l’information manquante, à l’aide de l’information périphérique : s’il y a un mur en béton à gauche et à droite du trou noir, il y incruste du béton. Evidemment, s’il y a un petit tableau suspendu à cet endroit précis, il sera bien en peine de l’y placer.
Ce point aveugle porte le nom de zone de Mariotte ; une expérience aisée à réaliser vous permettra de « percevoir » la vôtre – évidemment le terme de percevoir est impropre. Fermez votre œil gauche en fixant attentivement la croix du tableau ci-dessous, puis rapprochez-vous de la page ; à une distance d’environ 30 cm, le rond va disparaître, pour ensuite réapparaître (imprimez la page, le scintillement de l’écran peut perturber l’expérience).

Vous avez certainement fait, un jour ou l’autre, la désagréable expérience de la personne qui vient à vous tout sourire… et que vous ne reconnaissez pas ! Et pourtant, l’instant d’après, quand elle a décliné son identité, vous ne pouvez que rougir de confusion et vous confondre en excuses : mais comment donc avez-vous pu commettre un tel impair ?
Tout simplement parce votre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur, il ne compare pas un à un chaque visage rencontré à tous ceux précédemment enregistrés dans sa base de données : toutes les faces déjà rencontrées sont liées à d’autres souvenirs, d’autres contextes : un professeur à l’école où il enseigne, un collègue de bureau à la société où vous travaillez ; bien sûr, vos amis les plus proches participeront d’un nombre élevé d’environnements contextuels.
De fait, quand vous pénétrez dans l’immeuble qui abrite la société où vous travaillez, tous les visages liés à ce contexte seront plus aisément disponibles que ceux corrélés à l’université, où vous avez passé certes de longs mois, mais que vous avez quittée il y a maintenant deux ans. Et de fait, vous risquez de passer à côté d’un de vos anciens professeurs sortant du bureau de votre directeur sans même le reconnaître.
12:55 Publié dans Sciences Cognitives | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
29/03/2006
L’image de marque au fond d’une assiette de soupe
L’image de marque existe, nous confirmaient récemment les spécialistes des sciences cognitives : elle facilite notre perception des produits qui s’offrent à nous. En favorise-t-elle pour autant l’achat ? Moins sûr !
 Le contenu en était, à l’origine, extrêmement simple : elle se chargeait des caractéristiques factuelles et fonctionnelles des produits commercialisés – des berlines familiales et fiables ; une lessive efficace mais qui affadit les couleurs ; etc. De quoi éviter à la ménagère de se poser sans cesse les mêmes questions en faisant ses courses, la mémoire à long terme contribuant logiquement à la perception et l’identification des biens.
Le contenu en était, à l’origine, extrêmement simple : elle se chargeait des caractéristiques factuelles et fonctionnelles des produits commercialisés – des berlines familiales et fiables ; une lessive efficace mais qui affadit les couleurs ; etc. De quoi éviter à la ménagère de se poser sans cesse les mêmes questions en faisant ses courses, la mémoire à long terme contribuant logiquement à la perception et l’identification des biens.
Un peu comme lorsque je reconnais un ami dans la rue, et sait qu’il va me tenir la jambe si ne l’évite pas parce qu’il est particulièrement bavard ! Ou qu’il peut se révéler de conseil avant d’acheter un lave-linge.
Au fil des ans marketers et publicitaires en ont profondément modifié, non la nature, mais le contenu, l’enrichissant de valeurs superfétatoires : cau-tion de qualité, initialement fondée sur l’analyse très fine des motivations et des freins, elle s’est peu à peu muée en en symbole d’appartenance, en véhicule identitaire : la liste serait longue, de la BMW des cadres dynamiques d’hier au sportswear Com8 des banlieues d’aujourd’hui !
Ce qui caractérisa même la société de consommation, à en écouter Baudrillard : « Les objets ne s'épuisent jamais dans ce à quoi ils servent, et c'est dans cet excès de présence qu'ils prennent leur signification de pres-tige, qu'ils "désignent" non plus le monde, mais l'être et le rang social de leur détenteur… »
Ce faisant, ils ont même cru modifier la nature même de l’image – la détourner de sa fonctionnalité initiale : aider à la perception ; et lui en substituer une nouvelle : favoriser, influencer l’achat. Car n’est-ce pas là ce qui sous-tend nombre de modèles de pré-testing publicitaire, où l’on évalue successivement les effets d’une annonce sur une image de marque – et notamment ses attributs subjectifs –, puis son pouvoir de persuasion… et les corrélations sous-jacentes.
Toutefois, si la BMW constitua une des incontournables règles d’appartenance à une élite sociale, le T shirt Com8 – la marque de Joey Starr – re-présente plus l’exception communautaire : les consommateurs rejettent de plus en plus la dictature des marques, comme en apportent la preuve le succès du livre de la journaliste canadienne Naomie Klein : No logo, ou les récents déboires de Nike par exemple*. Sans développer plus avant la question ici, force est de reconnaître que les valeurs identitaires déclenchent de moins en mois d’actes d’achat : il suffit de voir le succès des produits low costs ou des non marques pour s’en convaincre.
Dès lors, toutes les dimensions dont les publicitaires ont peu à peu chargé l’image de marque se révèleront bien inutiles : à quoi bon vanter le prestige lié à la possession d’un porte-plume laqué auprès de bobos qui considèrent que tous les stylos se valent bien !
Dès lors, les marques doivent à nouveau se battre sur leurs composantes fondamentales : fiabilité, fonctionnalité, ergonomie, gustativité ; d’aucuns comme Danone ont déjà bien entamé la réflexion en vendant de la santé et du bien-être, bien au-delà de la simple alimentation.
L’exercice présente quelques limites : la seule qualité ne justifie plus des marges aussi confortables à l’heure où bien des consommateurs estiment qu’il n’y a plus vraiment de mauvais produits et achètent en toute confiance des marques inconnues – d’où le recentrage de la bataille sur les prix !
Le champ compétitif s’en trouve soudain restreint : à quoi bon alors gas-piller son argent en publicité, simplement pour crier – comme tous ses concurrents – que l’on est le meilleur, quand les clients ne distinguent pas vraiment de différence ?
Heureusement les chercheurs de l’Université du Wisconsin** viennent ici au secours des publicitaires : ils proposé à des volontaires une boisson désagréable, en affirmant à une partie d’entre eux qu’il s’agissait d’une bonne soupe, et l’inverse aux autres. Résultat : les premiers l’ont jugée acceptable, les autres infecte !
Sans nous attarder sur les modifications de l’activité cérébrale engendrées par les avis préalablement exprimés – deux zones apparaissant plus parti-culièrement concernées, l’insula et l’opercule droit –, retenons simplement que les cogniticiens arrivent à détecter avec précision les fonctionnements sur le cerveau des mécanismes d’influence.
Et qu’une image riche déclenchera plus efficacement l’achat qu’une autre – sous réserve que le différentiel de prix demeure acceptable : les publici-taires ont encore de beaux jours devant eux – cependant un peu plus durs qu’auparavant !
*La firme américaine proposant de personnaliser ses chaussures d’un mot choisi par ses clients, un internaute, Jonah Peretti, souhaita inscrire sur les siennes le mot « sweatshop » pour « rappeler l’effort et le travail des enfants qui ont fabriqué mes chaussures ». Refus embarrassé de Nike qui découvre avec stupeur, mais trop tard, la publication de la demande, et surtout de ses réponses gênées, sur divers sites du Net.
**Résultats publiés sur : http://www.nature.com/neuro/index.html
21:25 Publié dans Sciences Cognitives | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |