06/04/2006
Enlarged Consumer Insight Network : La révolution copernicienne
 1. Introduction
1. Introduction Jusqu’à l’explosion de la bulle technologique, la problématique de l’innovation ne se posait que très marginalement au sein des entreprises du monde du high tech : informatique, électronique grand public, photographie, etc. Dans ces sociétés, les ingénieurs conduisaient de vastes programmes de recherche dont les chefs de produits transformaient les principaux résultats en des appareils révolutionnaires que les marketers lançaient sur le marché pour le plus grand bonheur de leurs clients qui les achetaient le plus naturellement du monde.
C’est ainsi qu’à l’époque des téléviseurs en noir et blanc, nul ne s’est jamais posé la question de l’éventuel intérêt des consommateurs pour des écrans en couleurs ; de même, toute la réflexion – et les investissements – dans la téléphonie mobile s’est déroulée sans personne ne se pose réellement la question d’un éventuel marché : il était évident que le GSM connaîtrait un succès comparable au fixe en son temps.
L’industrie avançait à marche forcée, car les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dopaient le marché. Jusqu’au jour des premières catastrophes : Iridium, cet extraordinaire projet de téléphonie satellitaire qui a fait faillite après avoir inutilement lancé plus de cinquante satellites dans l’espace ; le WAP, qui devait renouveler la téléphonie mobile, entre GSM et UMTS ; le magnétoscope Digital VHS, qui a tenu six mois en rayons avant de sombrer dans la plus totale indifférence.
Soudain, les entreprises high tech se sont aperçu que les nouvelles technologies généraient désormais auprès des consommateurs plus de freins que de motivations – voire quasiment exclusivement des freins ! Evidemment, cela remettait en cause les fondamentaux du marketing et de la communication, de Dichter à Joannis. D’où une double nécessité de diagnostic et d’adaptation, débouchant sur la mise en place de nouveaux process et de nouveaux outils.
2. Le diagnostic
Le diagnostic est assez simple : nous nous situons dans une espèce de no man’s land sociologique, entre une société de consommation moribonde, et une nouvelle civilisation dont nous ne pouvons saisir que des bribes extrêmement parcellaires. La question essentielle est avant tout de comprendre comment nous en sommes arrivés là avant de proposer une vision marketing adaptée à cette nouvelle donne.
2.1. La fin du rêve technologique
Il n’y a pas encore si longtemps, beaucoup auraient dépensé des fortunes pour figurer parmi les premiers à acquérir les nouveaux téléviseurs à écran plasma, les derniers organiseurs surpuissants directement connectables sur Internet, les nouveaux DVD Audio qui nous plongent au cœur de la musique. Désormais, la fête semble bien finie, et ce qui hier nous faisait encore tant rêver, nous fascine soudain beaucoup moins – voire même inquiète, parfois effraie : dès que l’on organise une réunion de consommateurs pour traiter du sujet, revient sans cesse l’image, à la fois effrayante mais très consensuelle, des appartements de « 1984 » et de leurs innombrables télécrans.
La récurrence du spectre Orwellien apparaît révélatrice d’une forte extrêmement forte appréhension à l’égard de la technologie : que l’on parle ordinateur, télévision, téléphonie, il surgit au détour d’une phrase dès que l’on demande aux interviewés de se projeter dans un futur plus ou moins proche. L’aisance avec laquelle il franchit la frontière de l’inconscient montre combien anxiogène apparaît un avenir frappé du sceau de cette fameuse révolution digitale dont les médias nous tant vantés les mérites il y a à peine cinq ans.
Hier si prometteur, le high tech numérique semble désormais ne plus générer que des freins : la multiplication des standards (ou plutôt leur absence) liée à la rapide obsolescence des produits conduisent les consommateurs au plus parfait attentisme – d’où la récente tendance au slow tech (refus d’acheter hardware et software les plus récents par crainte de bugs à répétition). Et les réticences grandissent exponentiellement face à une technologie que l’on ne maîtrise plus : la fracture digitale, qui exclut de plus en plus de citoyens, n’est plus seulement liée au pouvoir d’achat des ménages.
Le progrès technologique, nous y avons cru – et nous y avons souscrit : voyez la téléphonie mobile ! Dans un monde où les temps de déplacement augmentent quasi exponentiellement, les horaires deviennent fluctuants (il faut certains jours une demi-heure pour traverser la capitale, et le lendemain trois ou quatre fois plus) et les rencontres aléatoires (comment prévenir de son retard quelqu’un qui vous attend à un carrefour quand on est soi-même coincé dans un embouteillage ?), elle n’est pas de l‘ordre du superflu, même très agréable, mais du nécessaire.
Mais voilà qu’à peine équipés, alors que même que nous ne savons pas encore parfaitement gérer ces petites merveilles qui encombrent nos poches, voilà que les opérateurs nous proposent de changer d’appareils et de souscrire au WAP – l’Internet sur le mobile ! Allons donc, rien ne presse ! Si nous répondent-ils, car d’ici un an, ce sera l’UMTS, la 3G – la Troisième Génération. Et les consommateurs de ne rien faire, ni WAP, ni 3G : trop, c’est trop !
On multiplierait les exemples à l’infini. Ainsi des lecteurs DVD : à peine nous étions-nous équipés, qu’il nous fallait changer de matériel pour lire les CD gravés sur nos ordinateurs, puis à nouveau pour les films au format DivX ; aujourd’hui à peine sortis les graveurs de la première génération que pointent ceux de la seconde, à base de lasers bleus !
Trop, c’est trop, et le consommateur appuie sur le frein : il ne rejette pas tout en bloc – la tendance au low tech, ou réticence très élevée à tout ce qui touche au high tech, demeure marginale – mais se réserve un droit d’inventaire.
Pour ne garder que ce qui lui apparaît utile… et lui confère un pouvoir dont il ne disposait pas auparavant. Prenons l’exemple de la musique : dans les années soixante, les jeunes qui souhaitaient acquérir le dernier disque des Beatles, n’avait d’autres choix que de payer le tarif étiqueté dans les bacs… ou d’y renoncer. Aujourd’hui, il leur suffit d’aller sur Kazaa ou eMule pour télécharger gratuitement les chansons de leurs artistes préférés.
Il n’existe donc plus une, mais deux réalités économiques : celle des industriels, et celle des consommateurs. Jusqu’à ces dernières années – et c’était en fait cela le modèle ancien – la première l’emportait sur la seconde et les clients se pliaient à la loi des producteurs. Le modèle économique nouveau, c’est la prise du pouvoir par un consommateur qui fixe son prix d’achat au plus près de son prix psychologique.
Tous les secteurs sont concernés : ainsi, avant d’acheter un lave-linge, ce dernier se rend sur Google, tape « lave-linge » et reçoit avant toute autre information, celle des comparateurs de prix. Et les vendeurs des boutiques spécialisées voient débarquer des clients qui non seulement leur imposent un prix plafond, mais se montrent capables de réfuter toute contre argumentation, parce que mieux documentés – au sein des forums de discussion, les férus de technique aident les néophytes.
Les consommateurs ont changé – grâce et par Internet – et aujourd’hui ils refusent de n’être que simples clients ; le Web leur en a donné le pouvoir – un pouvoir dont ils ne sont pas prêts à se dessaisir.
2.2. La mort de la société de consommation
Hier, c’était une sorte d’élan général, d’enthousiasme collectif pour le high tech – mais aussi pour tous les produits flamboyants d’une société très ostentatoire ; aujourd’hui, cela ressemble plus à un divorce, pas vraiment à l’amiable, entre deux représentations du monde : celle du citoyen, du consommateur d’un côté ; et celle des chercheurs, des industriels, relayée par les médias, de l’autre. Deux univers que plus rien ne rapproche, mais qui au contraire dérivent de plus en plus rapidement loin l’un de l’autre.
D’aucuns diagnostiquent dans les convulsions actuelles qui la secouent, une de ces multiples crises que traverse régulièrement notre société de consommation, de la crise existentielle de la fin des années soixante, à celle née au cours de la décennie suivante, des deux chocs pétroliers successifs ; et de chercher tant bien que mal à élaborer de nouveaux outils pour y répondre comme en d’autres temps d’autres marketers ont peaufiné pareilles tactiques pour affronter d’autres crises - boursières, environnementales, éthiques, etc.
En attendant que tout redevienne normal.
Et en commettant ainsi deux erreurs manifestes. Tout d’abord parce que tout ne redeviendra pas normal – pas comme avant – et que ce n’est pas une attitude à la Hoover qui améliorera la situation. Certes, la crise économique est certainement très passagère – mais ce n’est pas parce que l’activité redémarrera que les consommateurs se rueront à nouveau dans les magasins pour s’équiper comme aux belles heures de la bulle technologique.
Mais surtout, la crise actuelle est plus sociologique qu’économique : la réalité aujourd’hui est que la société de consommation – vilipendée dès la fin des années soixante, exsangue après un quart de siècle de bégaiement économique, rapidement balayée d’un revers méprisant par les pères de la Nouvelle Economie – s’effondre sur elle-même.
La Nouvelle Economie ravivera en effet des espoirs vieux de plus d’un quart de siècle, d’avant la crise : changer le monde, lui donner un visage plus acceptable. Et pas seulement pour des étudiants fraîchement débarqués sur le marché du travail, et pour la première fois confrontés à la réalité économique ; mais également pour ceux qui avaient leur âge au début des années soixante-dix – et qui maintenant tiennent les rennes de la Nouvelle Economie : les Steve Case et autres Bill Gates, que David Brooks qualifiera de Bobos.
Peut-être les opérateurs de la Nouvelle Economie méprisaient-ils suffisamment l’argent pour ne pas se soucier plus avant de la solidité de leurs business models – les banquiers et autres financiers seraient d’autant plus coupables de s’être laissés si aisément éblouir par les feux de la technologie ? Peut-être également, et très implicitement, sentaient-ils que ce qu’ils créaient importait nettement plus que les sommes qu’ils devaient, à terme, récupérer ? Peut-être même considéraient-ils, pour certains d’entre eux, que l’argent constituait plus un des multiples moyens – nécessaire, mais un moyen cependant – de faire vivre leurs projets et non plus une fin. Et ce faisant, ils reniaient la logique capitaliste – comme ils l’avaient fait en 1968.
Et nous voici donc à la frontière entre deux systèmes qui se succèdent en ciseaux, l’un s’en venant peu à peu combler le vide laisser par le premier : exactement comme il y a plus d’un demi-siècle, la société de consommation s’est doucement imposée sur les cendres d’une autre société, plus traditionnelle, fondée sur des identités culturelles et nationales fortes, profondément ancrée au sein des peuples, mais qui s’en était violemment venue butter dans le mur de deux guerres mondiales – et que l’exode rural rendait ipso facto obsolète.
La société de consommation, elle, s’en est venue butter sur la bulle technologique et la réalité aujourd’hui est que nous nous situons dans une sorte de no man’s land sociologique, entre deux sociétés – deux civilisations pourrions-nous dire – et que ce que nous avons besoin, ce n’est certainement plus des recettes adaptées à la société de consommation, mais des recettes adaptées à ce no man’s land. Nous sommes dans le brouillard le plus complet, nous naviguons à vue, sans autre certitude que désormais le consommateur a repris le pouvoir, et il n’est pas prêt de le lâcher.
3. L’adaptation
La problématique de l’adaptation est plus compliquée car elle appelle une totale remise en cause des habitues héritées du passé ; elle nécessite préalablement d’identifier les conditions actuelles de succès des nouveaux produits technologiques, afin de déterminer les process les mieux adaptés à cette nouvelle donnes et se doter des outils adéquats.
3.1. Les clefs du succès de l’innovation technologique
L’innovation technologique constitue un processus de longue haleine, les ingénieurs se lançant dans des aventures à l’issue incertaine. Depuis des années, dans différents pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie, des centaines de chercheurs tentent de résoudre l’épineux problème de la reconnaissance vocale. On entrevoit aisément une multitude d’applications au terme de cette démarche : dans l’électronique grand public, en informatique, mais également dans l’automobile, la domotique, etc. Toutefois, bien des mois passeront encore avant que tous ces travaux ne se concrétisent au sein d’appareils largement diffusés.
L’innovation se situe à la conjonction de deux mouvements contraires : une offre technologique brute, non ordonnée et par là même non signifiante ; et son accaparement par des individus, son appropriation au sens littéral du terme. Les produits nouveaux n’existent que dès qu’ils échappent à leurs géniteurs, quand les consommateurs leur donnent une raison d’exister, une utilité, une valeur d’usage. Ils naissent de l’improbable rencontre d’individus que tout oppose.
D’un côté des ingénieurs, brillants, capables de découvertes et inventions fantastiques ; toutefois ces dernières ne sont pas des produits finis mais de simples briques technologiques, sans intérêt pratique pour l’utilisateur lambda : compression dans un rapport de 1 à 10 de morceaux musicaux sans altération, écriture de données numériques sur des galettes de plastique par des faisceaux laser, transmission ultrarapide de données sur une simple paire téléphonique, etc.
De l’autre, des consommateurs souvent bien effrayés face à la complexité des objets qu’ils manipulent : penser que le petit assistant que l’on tient dans le creux de sa main possède plus de puissance que les ordinateurs qui dans les années cinquante occupaient des salles entières ! Et qui surtout se seraient bien montrés incapables d’imaginer les services que leur rendraient un jour les taux de compression et autres faisceaux laser précédemment évoqués, eux qui gravent les fichiers mp3 qu’ils téléchargent si aisément grâce à leur connexion ADSL.
DVD ou assistant personnel, téléphone mobile ou baladeurs numériques, peu ou prou, ces appareils ont rencontré un public, un marché s’est développé, ce qui n’est le cas, ni hier de la cassette numérique audio, ni aujourd’hui du WAP. Certainement rien de cela n’est figé et tel produit qui ne fonctionne pas aujourd’hui aurait hier – ou demain – séduit les foules. Mais pourquoi le WAP a-t-il subi en France un échec aussi retentissant quand son équivalent asiatique, l’i.Mode, s’imposait si rapidement comme le moyen de communication fétiche des adolescents japonais ?
Parce que contrairement au WAP, il répondait à un besoin profond. La société japonaise diffère profondément de la nôtre : alors que nous nous partageons entre domicile et lieu de travail, les Japonais équilibrent leur temps entre bureau (quitte à y dormir en début de matinée) et « dehors » ; maisons et appartements ne constituent généralement que de brefs lieux de passage. Certes, nous allons au cinéma, au restaurant – mais alors nous faisons « une sortie », jamais nous ne revendiquerions ces endroits comme les nôtres.
Leurs appartements ne sont guère confortables : les familles s’entassent dans des pièces exiguës aux frêles cloisons, plusieurs générations cohabitant sous le même toit – les prêts immobiliers passant de père en fils, on s’endette pour une vie, et même plus ! Traditionnellement, les hommes passent la soirée loin de chez eux, dans les bars du centre des villes, notamment à Tokyo ; les jeunes se sont adaptés à cette existence nomade, ne rentrant chez eux qu’à minuit passé. Les sociologues assimilent cette itinérance, commune à toutes les mégalopoles asiatiques, au mythique « troisième lieu de convivialité », décrit par Ray Oldenburg dans son livre The great good place.
Dès lors, les jeunes Japonais peuvent légitimement souhaiter disposer « à l’extérieur » – sur leur lieu de vie principal – des mêmes outils que nous utilisons à domicile, et notamment Internet – ou du moins certains services en ligne indispensables à une existence nomade : programmes des spectacles, adresses de restaurant, envoi de messages, etc. C’est-à-dire quelque chose plus proche de notre vieille télématique que du Web : peu importent l’ergonomie – même si cette dernière a bien progressé – et la richesse des contenus, seules priment efficacité et praticité.
Depuis l’i.Mode a gagné des couleurs, véhiculant musique et images, et les opérateurs européens s’interrogent sur l’opportunité de lancer de tels services chez nous ; E-Plus, troisième opérateur allemand, a le premier franchi le pas en s’alliant au japonais pour lancer le service dans ce pays. Car rien n’est trop beau pour séduire le consommateur : « En comparaison avec l’i.Mode, le WAP, c’est l’époque de la craie », revendique le directeur d’E-Plus , oubliant que le seul produit qui ait réellement marché en Europe depuis le lancement de la téléphonie mobile, c’est le SMS, auquel nul marketers n’avait jamais cru.
Le SMS, cet ersatz de la communication, équivalent français de l’i.Mode japonais qui fait rêver tous les opérateurs de la téléphonie mobile ? Mutatis mutandis, très certainement. Nomade, la société nippone réclamait des outils de communication, non pas puissants ou sophistiqués, mais adaptés à un mode de vie extrêmement mobile. Ecoliers et étudiants hexagonaux se groupent en réseaux, plus ou moins structurés ou informels – des bandes aux usages très codifiés aux réunions de circonstance autour d’une idée ou d’un projet ; le SMS, constitue pour eux le moyen le plus simple et le plus efficace de rester en contact.
Autant les Japonais partaient en quête d’outils d’accès à l’information en complément des fonctions constitutives de la téléphonie mobile – ajout de services à forte valeur ajoutée –, autant les jeunes Français réclamaient un moyen de relation purement phatique - en retrait par rapport à l’outil de base, puisqu’ils renoncent ainsi à la voie de retour et l’interactivité : « Ça me suffit pour dire à un ami que je pense à lui, sans avoir à discuter pendant des heures. »
Aucun de ces produits n’est superflu : ils se fondent sur des comportements et des usages différents et ne sont pas interchangeables car ces deux sociétés, l’européenne et la nippone, se développent en des directions différentes. Ce n’est pas parce l’i.Mode est désormais nettement en avance sur ses concurrents – WAP, GPRS et autres MMS – qu’il doit s’imposer aussi rapidement à Berlin qu’à Tokyo : les consommateurs n’achètent pas un produit technologique parce qu’il est particulièrement performant, mais parce qu’il leur est utile.
Ou plus précisément, parce qu’il leur est utile à un moment donné. Parce qu’il apparaît sur le marché au moment où ils en ont besoin. Besoin profond pour le lave-linge au milieu du siècle dernier et le téléphone mobile, ou l’i.Mode japonais plus récemment ; besoin plus superficiel peut-être pour le SMS ; simple amélioration dans bien des cas. Si le besoin se révèle profond, l’innovation réduira le stress : coincé dans les embouteillages, je préviens de mon retard et arrive plus détendu à mon rendez-vous. S’il est inexistant, elle l’amplifiera.
L’innovation technologique ne peut se fonder sur la seule étude du consommateur comme pour les produits de consommation courante : quand s’ébranle le train de la recherche, celui à qui elle se destine n’existe pas encore. La métaphore la plus pertinente serait celle d’un avion gros porteur qui s’envole pour un pays lointain, constamment embrumé, sans cartes ; et qui plus est, en ignorant complètement si à destination il existe une piste d’atterrissage. Imprudent certes, mais sans autre choix non plus.
En fait, tout est une question de pilotage, puis d’atterrissage à vue.
Quand industriels et opérateurs se lancent dans l’aventure de la téléphonie mobile, tous espèrent rentabiliser un jour les investissements gigantesques consentis. Quand ? Difficile à dire, cela dépasse de loin les plans stratégiques à court ou moyen terme ; tout comme il est impossible d’imaginer un France Telecom, un Siemens, décidant de ne pas participer, de rester au bord du chemin : c’est la faillite assurée… un jour aussi. Et même plus tôt, car les analystes financiers ne leur auraient pas pardonné leur manque d’ambition : une entreprise se valorise également par sa recherche et ses brevets.
Le point de départ d’une innovation technologique peut-être l’intérêt d’un chercheur pour un domaine particulier – ou la seule motivation du défi à relever –, la veille technologique – pour ne pas dire l’espionnage entre concurrents –, voire le simple hasard ; plus simplement, la science progresse et les entreprises participent de ce vaste mouvement, tout comme les universités. Entre les uns et les autres, les échanges se révèlent souvent fructueux : l’institut Fraunhofer qui a mis au point le système de compression musicale mp3 possède en Allemagne le statut de fondation à but non lucratif, ce qui ne l’a pas empêché de s’appuyer sur des brevets appartenant à Thomson, qui aura en retour profité de ses travaux.
Difficile donc d’œuvrer dans l’ombre : tout le monde se lance en rang serré dans les mêmes batailles, ne serait-ce que pour ne pas se laisser distancer. Tous les industriels appareillent ainsi, sans idée, ni de l’itinéraire, ni surtout de la destination finale – c’est-à-dire sans savoir si quelque consommateur achètera, ou non, le produit qui sera in fine proposé en magasin.
La réelle question est d’ailleurs moins de savoir s’il achètera que sous quelles conditions : les investissements consacrés à la recherche ne sont jamais gaspillés en vain. Bien sûr, le WAP constitue un échec flagrant – mais les technologies élaborées pour sa mise au point resserviront pour les terminaux de troisième génération. Certes, le D-VHS a disparu des rayons avant d’avoir rencontré un public – mais les connaissances acquises quant à la digitalisation des enregistrements se révéleront ensuite très utiles pour le DVD Recorder.
Inversement, même si France Telecom, Deutsche Telecom et les autres opérateurs européens rentabilisent un jour les travaux nécessaires à la mise au point du WAP et des applications similaires, la situation de NTT Docomo n’en apparaîtra pas moins plus souriante que la leur : le Japonais aura bénéficié d’un retour sur investissements nettement plus rapide, tandis que ses concurrents occidentaux ont – pour l’heure – déployé des efforts considérables en pure perte.
Rater son atterrissage, c’est au terme d’un long processus de recherche se tromper d’application, chercher à commercialiser un produit qui, malgré son avance technologique séduira moins que ceux de ses concurrents. La sanction se traduit toujours par une perte de parts de marché. Les magnétoscopes Bétamax de Sony et V 2000 de Philips valaient bien les VHS de JVC – nombreux spécialistes les ont même jugés supérieurs –, mais les acheteurs leur ont préféré la norme universelle.
Réussir son atterrissage, c’est savoir adapter sa trajectoire au fil des ans pour parvenir à proposer au consommateur un produit convenable, au bon endroit, au bon moment : ne pas chercher à lui imposer un système propriétaire quand il cherche à se rassurer sur la pérennité de ses achats au travers de normes très largement diffusées ; ne pas tenter de lui vendre le Télétexte là où le Minitel est roi ; mais savoir lui offrir des monospaces quand l’envie de confort l’emporte sur le désir de vitesse.
Réussir son atterrissage, ce n’est pas chercher désespérément une piste au dernier moment, dans l’urgence, quand ses compétiteurs se pressent dans les starting blocks, mais suivre en permanence les évolutions de la société à court, moyen et long terme. Ou plutôt à l’inverse : appréhender les mutations fondamentales, dont les répercussions se ressentiront encore à des années de distance ; saisir les tendances les plus fines, pour traduire ses innovations, les ancrer au sein d’applications acceptables et cohérentes ; puis se donner finalement les moyens de surfer sur les modes, et les codes de communication, pour le fine tuning.
En un mot : préempter le futur.
4. Nouveaux process et nouveaux outils
Réussir son atterrissage, surtout dans d’aussi mauvaises conditions météorologiques qu’aujourd’hui, nécessite de disposer d’instruments de navigation extrêmement fiables, pour ne pas courir le risque de s’écraser lamentablement à côté de la piste le jour venu, c’est-à-dire de se doter des études permettant d’appréhender les évolutions à court et long termes de la société contemporaine – et notamment les attentes et attitudes à l’égard des produits technologiques.
Etudes à long terme, pour fixer et maintenir le cap. Etudes à court terme, pour finaliser l’approche et réussir le lancement du bien ou service fruit de longues années de recherche. Outils de test pour valider les hypothèses de développement de produits et services… et réinscrire le consommateur au cœur des préoccupations.
4.1. Consumer Insight et Consumer Insight Network
Cette vision systématique, continuelle, presque obsessionnelle du consommateur, nous la nommerons Consumer Insight – pour mieux la distinguer d’une approche classique qui consisterait à en prendre ponctuellement le pouls, en des instants clefs et privilégiés. Le Consumer Insight se caractérise par une perpétuelle interrogation sur le consommateur : non seulement, au travers des produits qu’il achète, mais également quant à ses aspirations les plus variées, ses modes de vie.
Dans sa globalité. Dans une double globalité temporelle et individuelle.
Temporelle, parce qu’on ne saurait quitter un instant des yeux un individu qui se transforme continuellement – et extrêmement rapidement, déjouant tous les pièges que lui tend encore une société de consommation déliquescente : téléchargeant gratuitement sa musique quand les majors s’ingénient à la lui vendre ; zappant de sa télévision à un week-end à la campagne, quand on espère le retrouver sur Internet ou dans les centres commerciaux ; s’inventant des après-midi de shopping sous prétexte de 35 heures et de jours à récupérer. Totalement imprévisible !
Dans sa globalité d’individu, également, et pas de simple consommateur – ou pire, de consommateur de produits high tech – tant les interactions apparaissent nombreuses. Ainsi le nomadisme des adolescents conditionne-t-il non seulement une alimentation déstructurée : snacking, fast food, sandwicheries turques ; un habillement fluide : sportswear, baskets ; des accessoires sportifs : rollers ; mais également toute une kyrielle d’équipements électroniques, du téléphone mobile aux baladeurs numériques, et aux appareils hybrides : téléphones musicaux, vidéo juke-boxes, etc.
Ceci conditionne un double élargissement – une posture marketing élargie – et la nécessité de passer d’une simple approche marketing au développement d’un réseau interne et externe de type Consumer Insight Network.
En interne, sous forme d’un vaste réseau de connaissance. Bien sûr en alimentant en informations choisies tous les collaborateurs travaillant sur un projet spécifique, en les encourageant à assister non seulement aux présentations de résultats d’études, mais également aux multiples groupes qualitatifs qui en jalonneront l’avancée. Mais aussi en pratiquant la fertilisation croisée, en facilitant l’accès de tous à l’ensemble des données quantitatives et/ou qualitatives disponibles en interne.
Veilles technologique et sociologique, études de tendances, revues de presse et documentaires compléteront utilement les travaux commandités et/ou réalisés par le service études : un article sur les communautés virtuelles publié par des universitaires, une pige iconographique japonaise et quelques réflexions glanées dans des news magazines ou des séminaires professionnels parachèveront ainsi une réflexion initiée en interne sur la téléphonie de troisième génération et ses conséquences sur la relation à la musique entre teenagers.
En externe, sous forme de partenariats, plus ou moins formels et formalisés. Toute approche de type Consumer Insight nécessite d’accéder au vécu des citoyens, dans tous les actes de leur vie ; ce qui signifie ne pas se contenter de simples descriptions superficielles de pratiques, d’usages, de modes de vie – d’où la nécessité en interne de provoquer la rencontre des ingénieurs et des vendeurs, des ergonomes et des designers, des brand managers et des planners stratégiques, etc., chacun apportant sa contribution à l’édifice commun : une meilleure vision/compréhension de sa clientèle finale.
En externe, les meilleurs spécialistes des comportements alimentaires s’appellent Danone ou Nestlé, des pratiques sportives, Décathlon ou Adidas, des goûts musicaux, NRJ ou Naïve, etc. Parce qu’au fil des ans, ils se sont constitués une irremplaçable expérience : souvent gros commanditaires d’études par ailleurs, ils ont été le témoin de tous les succès et de tous les échecs de leur profession – ils en ont décortiqué, analysé toutes les aventures, grandes et petites, anecdotiques ou non. Les écouter discourir se révèlera souvent très riche d’enseignement ; ce qui ne veut pas dire que leurs souvenirs remplaceraient utilement bien des études, mais simplement qu’ils apportent un éclairage complémentaire nécessaire, et par ailleurs inaccessible. Plus : un vécu.
En externe, le Consumer Insight Network réunira sous forme de club, des annonceurs complémentaires, mais non concurrents. Complémentaires, chacun apportant aux autres sa propre vision des consommateurs, de leurs modes de vie – de cette partie qu’ils connaissent le mieux : la leur. Comme un puzzle, c’est un nouveau citoyen qui se fera jour au sortir de ces réunions d’échanges au cours desquelles les uns et les autres auront évoqué leurs observations, leurs analyses, voire simplement leurs réflexions et leurs remarques. D’où cette notion d’un Enlarged Consumer Insight Network, c’est-à-dire débordant largement le cadre étroit de l’entreprise.
Le Network pourra prendre la forme d’un groupe de travail restreint, chacun de ses membres portant la parole de son entreprise : même si ses réunions ne peuvent être trop fréquentes, un réseau resserré pourra aisément et efficacement rester en permanent contact par courrier électronique, voire sur un Extranet dédié. A sa charge de synthétiser attentes et besoins de leurs sociétés et d’organiser régulièrement des séminaires inter sociétés où leurs collègues pourront alors profiter de l’apport des différents partenaires.
Mais le Network pourra nourrir d’autres ambitions, comme la mise en commun d’études – privatives ou souscription commune à des projets multi clients. Voire la réalisation de projets spécifiques, de plus grande envergure : une étude de tendance parfaitement adaptée à leurs exigences, dont ils maîtriseront totalement la méthodologie, par exemple. Ainsi ils éviteront l’écueil des travaux en multi souscription, relativement bon marché, mais nécessairement consensuels et limités ; et celui des projets ad hoc, qui répondent parfaitement à leurs désirs, mais hélas bien trop chers.
4.2. Consumer Labs
Au fur et à mesure de ses travaux, internes et externes, le Consumer Insight Network construit une expérience empirique du consommateur, les études qui la nourrissent intervenant soit très en amont, soit très en aval de la démarche marketing. Très en amont : les études de tendances à court et long terme, précédemment évoquées, et que nous approfondirons dans les prochains chapitres. Très en aval : toutes les étapes de validation, d’immersion consommateurs, sous forme de Consumer Labs. Précisons le concept.
Les approches traditionnelles – groupes projectifs, trade off quantitatifs, par exemple – montrent rapidement leurs limites. Tout d’abord, parce que les consommateurs se révèlent assez rapidement incapables d’exprimer d’autres attentes que des insatisfactions basiques et récurrentes, comme : « C’est compliqué ». Ce qui est vrai ; mais tant que les appareils n’obéiront pas à la voix, il est certain que les réunions de groupes résonneront toujours des mêmes antiennes.
Parce qu’ensuite, les consommateurs ne peuvent s’exprimer sur des abstractions : ils ne savent imaginer les bénéfices des concepts qui leur sont soumis, parce que se situant bien trop loin de leurs préoccupations quotidiennes. A quoi pourrait bien leur être utile un téléphone mobile qui leur annonce que le magasin devant lequel ils passent vient de recevoir le dernier disque de leur artiste préféré ou que l’auteur dont ils ont tant apprécié le dernier livre vient d’en publier un nouveau ? Techniquement, les techniques de localisation sont au point ; mais imaginez : un téléphone quasi autonome, quasi vivant ! Même les jeunes, réputés plus imaginatifs, peinent à briser le cadre étroit de la réalité quotidienne.
Ce sont les approches quantitatives qui perdent le plus rapidement leur pertinence : comment les interviewés pourraient-ils percevoir en quelques minutes tout l’intérêt de concepts en totale rupture avec leur vécu quotidien ? Or pourtant, c’est ce que présuppose ce type de sondages : que le répondant comprenne parfaitement – et quasi instantanément – une problématique qui nécessiterait de longues et patientes explications. Réaliser aujourd’hui un trade off entre un enregistreur à disque dur – produit sans réelle référence dans le domaine de l’électronique grand public – et un graveur de DVD – simple amélioration d’un appareil extrêmement banalisé – constitue une gageure : jamais ils n’apparaîtront au même niveau de compréhension.
Le qualitatif qui autorise de longues – parfois très longues – mises en situation, permet de contourner l’écueil. Un qualitatif essentiellement fondé sur l’observation, qui ne recourra que très modérément aux techniques projectives – la difficulté n’étant pas ici de faire remonter un non-dit à la surface – mais favorisera l’appropriation – positive ou négative – des produits par un consommateur présupposé peu imaginatif. C’est essentiellement cette mise en situation qui distinguera les Consumer Labs des autres tests qualitatifs – des réunions de groupe classiques.
Revenons-en à notre comparaison des avantages respectifs d’un enregistreur à disque dur et d’un graveur de DVD : quelles que soient les explications fournies, les consommateurs ne pourront pleinement réaliser – intégrer – ce que pourrait être l’utilisation quotidienne d’un enregistreur numérique, tandis que le graveur de DVD constitue déjà presque pour eux une réalité, avant même sa commercialisation. Se posent alors au marketing deux interrogations complémentaires : comment effectuer le fine tuning de ces produits ? Comment les positionner sur le marché, sachant qu’ils entreront nécessairement à la fois en concurrence (produits simples) et en complémentarité (produits hybrides) ?
Il conviendra de donner à l’enregistreur une réalité, un vécu qui lui font défaut, pour le remettre à un niveau d’égalité avec le graveur de DVD de salon : pour ce-la, nous pourrons équiper pendant deux à trois semaines – les « upgrader » – des consommateurs avec des prototypes ou des préséries, que nous pourrons suivre tout au long de leur découverte en famille – éthologie, ergonomie, interviews non directifs – avant de les réunir en groupes à l’issue de cette période.
Si une telle approche permet de finaliser le design du produit, ses interfaces, son ergonomie, elle ne suffit pas à le positionner, parce que les futurs clients, eux, se révéleront plus proches de nos consommateurs inexpérimentés que des upgradés : leurs craintes, leurs espérances seront différentes. Où se situe alors la vérité ? Nulle part, et partout : il conviendra d’organiser en parallèle des groupes réunissant des individus vierges de toute expérience. Seule une attentive comparaison des deux populations permettra de déterminer ce qui sera nécessaire de dire, ce qui sera acceptable, ce qu’il faudra dans tous les cas passer sous silence. Sinon, le risque sera grand de sous vendre – ne séduire personne – ou, au contraire, de survendre – et décevoir ensuite.
Certaines expérimentations nécessiteront de lourds équipements, comme la reconstitution in vitro d’espaces de vie réalistes : studios, appartements, maisons, disposant évidemment de moyens d’observation sophistiqués – caméras panoramiques et micros stratégiquement placés, régie de contrôle et d’enregistrement, et glaces sans tain. En de telles installations, des consommateurs pourront tester, en toute tranquillité, produits et services futuristes : les découvrir, s’acclimater, les dominer, et un mot – au bout d’un laps de temps plus ou moins grand – les utiliser « naturellement ».
Les relations annonceurs/instituts en seront affectées, ces derniers ne pouvant s’équiper de tels Home Labs : les tests s’effectueront en des laboratoires sociologiques appartenant à leurs clients industriels, et non plus dans leurs locaux. Par ailleurs, la complexité des techniques mises en œuvre ne permet plus de changer souvent de fournisseurs car ces derniers doivent acquérir un certain niveau d’expertise, non des techniques, mais des relations des consommateurs aux produits technologiques innovants. L’osmose entre spécialistes des sciences « dures » - les ingénieurs – et des sciences « molles » - psychologues et sociologues – doit être parfaite.
La nécessaire imprégnation de ces derniers pourra conduire à deux attitudes radicalement opposées : tisser de véritables liens de partenariat avec une ou deux agences très impliquées, ou inversement, intégrer animation et analyse en interne. Dans les deux cas, la finalité reste la même : que les chargés d’études participent pleinement de toutes les expériences, qu’ils s’en imprègnent totalement.
Au fil des mois, ce sont de nouveaux process, de nouvelles approches méthodologiques voient le jour, qui peu à peu bouleversent non seulement la pratique quotidienne du marketing, mais également les rapports entre partenaires : alors que le Consumer Insight Network réunit des sociétés œuvrant en des domaines différents, parfois éloignés, les Consumer Labs conduisent quant à eux, soit à tisser des partenariats particulièrement étroits entre annonceurs et instituts, soit, inversement, à… se passer de ses derniers !
Les études de tendances à moyen terme fournissent un autre exemple de ces nouveaux rapports, les industriels pouvant jouer ici un rôle précurseur et moteur bien loin de la pratique courante. Ici encore, ils ont les premiers identifiés les besoins – comprendre comment s’effectue l’actuel saut d’une civilisation à l’autre, à quelle vitesse, avec quelles implications, etc. – et se sont rapidement tournés vers leurs conseils pour trouver réponse à leurs interrogations – sans grand succès hélas.
Car si les instituts avaient bien senti leur désarroi face à des mutations sociétales qu’ils ne maîtrisaient strictement pas, ils ne cernaient que très imparfaitement la problématique, et ne pouvaient apporter de réponse satisfaisante ; inversement les annonceurs, isolément, ne pouvaient financer des travaux de si grande ampleur.
Pour parler de notre propre expérience de département marketing au sein d’un groupe électronique, ceci nous conduisit dans un premier temps à nous rapprocher d’annonceurs impliqués dans des champs connexes – avec les acteurs de la téléphonie ou de l’informatique, nous partageons certaines préoccupations quant à la connectivité domestique – ou non : alimentaire, automobile, etc. Avec le double constat que nous n’avions ni la réponse, ni, individuellement, les moyens de financer les recherches nécessaires.
Dès lors, nous avons très informellement établi une sorte de cahier des charges, mixant notre expérience et nos questions, et nous avons tout aussi informellement partagé nos réflexions avec quelques spécialistes reconnus de la profession des études de marché. Petit à petit, des liens se sont tissés : deux instituts aux domaines d’expertise très complémentaires ont proposé des ébauches de solutions.
Dès lors, nous avons travaillé de concert avec eux, challengeant leurs idées, et les aidant à mettre au point une intéressante étude visant à mesurer les tensions individuelles que créent les mutations sociétales qui nous frappent : alors que traditionnellement, les chercheurs cherchent à mesurer des oppositions entre individus, ici nous nous sommes attachés à évaluer les internes propres à chaque individu. De nos longues conversations était née une démarche particulièrement novatrice.
Mais le plus intéressant réside avant tout dans la nouvelle relation qui s’est ainsi établie entre nous – un annonceur, et même plutôt un groupe informel d’annonceurs, puisque de multiples échanges collatéraux et informels ont eu lieu – et deux instituts d’études de marché : les résultats seront commercialisés en multi souscription, et à un échelon international – sans qu’aucun des annonceurs ayant aidé à porter l’étude sur ses fonts baptismaux n’ait cherché à s’en réserver l’exclusivité.
5. Conclusion
Nous devons aujourd’hui faire face à des mutations sociétales sans – récents – précédents, et à des enjeux auxquels nous ne saurons jamais répondre isolément. Je ne saurais dire si la véritable révolution copernicienne consiste à accorder aux consommateurs une place sans égale au sein de la démarché marketing – cesser de les appréhender partiellement pour les saisir dans leur totalité de citoyens ; ou plus amplement, à redistribuer les rôles entre les différents acteurs du marketing, pour justement mieux comprendre ces derniers. Certainement les méthodologies vont se peaufiner, les alliances se préciser : la seule certitude sur laquelle nous puissions nous appuyer aujourd’hui, c’est que toutes les… certitudes d’hier sont bien obsolète et que c’est toute une démarche marketing qu’il convient de réinventer.
Article paru dans : Innovations technologiques : aspects culturels et mondialisation, Editions Hermès Lavoisier - 2006
22:37 Publié dans Articles, publications | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 



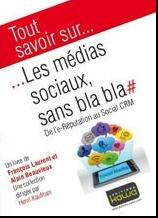






Les commentaires sont fermés.