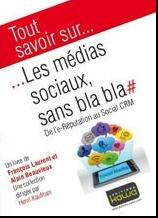14/06/2007
Et si on fondait une maison d’édition Web 2.0 ?
 Après ma musique, le métier qui souffrira le plus – et le plus rapidement – de Web 2.0 et de la dématérialisation des contenus sera très certainement celui de l’édition professionnelle.
Après ma musique, le métier qui souffrira le plus – et le plus rapidement – de Web 2.0 et de la dématérialisation des contenus sera très certainement celui de l’édition professionnelle. Dans les deux cas, la profession y a dérivé d’un marketing de l’offre très volontariste – avec parfois des partis pris risqués, mais toujours qualitatifs – à un marketing de la demande débouchant nécessairement sur des productions le plus souvent médiocres, pour lesquels les éditeurs refusent de prendre le moindre risque.
L’édition musicale, c’était hier des maisons comme Atlantic ou Motown, dénichant à coup d’intuitions géniales, des Ray Charles et des Marvin Gaye, et les soutenant de toute leur énergie : qui aurait raisonnablement misé sur un noir toxicomane… et aveugle de surcroît ! Personne sinon Ahmet Ertegun, fondateur d’Atlantic.
Aujourd’hui, ce sont quatre majors se partageant 80% du marché, et la plupart du temps incapables de comprendre, tant leurs artistes, que leurs publics ; dépensant des sommes folles en marketing pour assurer la promotion de gloires éphémères sorties de la real TV ; et étranglant à l’aide de contrats draconiens les valeurs montantes – pour ne pas parler du sort réservé aux groupes qui ne pénétreront jamais le Top 50, c’est-à-dire la quasi-totalité de la scène française ou mondiale.
L’édition professionnelle, ce sont désormais des éditeurs totalement incapables de discerner un bon projet d’un mauvais, et bétonnant de partout pour éviter de prendre le moindre risque : avec des directeurs de collections universitaires pour répliquer à l’infini les mêmes antiennes quand la société évolue plus vite que les thésaurisateurs.
Surtout, la première question que vous posera tout bon directeur littéraire sera : « Quelles préventes pouvez-vous me garantir ? » ; à ce petit jeu, il est plus aisé à un directeur d’institut ou d’agence de communication – qui va acheter des centaines d’exemplaires pour assurer la publicité de sa société – ou à un professeur de grande école de se retrouver sur les rayons des librairies.
Le seul petit détail que ces braves gens ont oublié, c’est très peu de professionnels espèrent gagner leur vie – ou même simplement changer de voiture – de leurs écrits, sauf les quelques rabâcheurs qui ressassent les sempiternelles théories du millénaire passé.
J’écris, plein de mes copains écrivent, simplement parce qu’ils ont quelque chose à dire – et que pouvoir dialoguer avec d’autres professionnels l’emporte de loin sur l’obole que ne leur accordera jamais un éditeur. Alors, comme des tas de copains, je blogge… et j’y trouve un plaisir immédiat, nettement supérieur à celui de discuter le bout de gras avec n’importe quel éditeur !
Blogger, c’est bien, mais qu’en reste-t-il ? Au terme de quelques mois, les papiers, classés par ordre ante chronologique, s’accumulent au fond de la pile… et sombrent dans l’oubli ; par ailleurs, même si l’on publie quelques papiers de fond, plus construits, la plupart du temps, la pensée demeure journalistique, donc parcellaire.
Et c’est alors que le livre trouve toute sa place, comme une somme : sauf quelques stakhanovistes, l’on en publie jamais que 3, 4, 5 au cours d’une carrière professionnelle. Et pour les anciens – nés, comme moi, au siècle dernier – il y aura toujours la magie de la chose imprimée, du papier, de cet objet que l’on découvre dans les rayonnages des libraires…
Un peu comme un artiste débutant aperçoit son tout nouveau CD dans les bacs disquaires… et en arrive à oublier qu’il ne touchera certainement pas un centime dessus, après être passé sous les fourches caudines des maisons de disque.
C’est pourquoi de plus en plus d’artistes leur font désormais un bras d’honneur, en publiant gratuitement leur musique sur MySpace ou leurs sites Internet : de toute façon, ils gagnent – aujourd’hui comme hier – leur vie en tournant de salle en salle ; alors, à défaut de revenus, Internet leur apporte la publicité – gratuite – que majors ou indépendants sont incapables de leur offrir.
Et si on fondait une maison d’édition Web 2.0 ?
Bien des schémas sont envisageables : vente à prix réduits ou totale gratuité ; diffusion totalement dématérialisée ou mixte ; modèle associatif, coopératif, ou banalement lucratif. Le problème le plus épineux restera certainement celui de la direction littéraire et de la sélection des auteurs et des projets.
Avec la dématérialisation des contenus, la mise à disposition gratuite de livres au format PDF ne constitue plus vraiment un obstacle, les auteurs se chargeant alors eux-mêmes de la mise en page de leurs écrits ; toutefois, une commercialisation à coûts très réduits – quelques euros – peut également s’envisager.
En parallèle de cette diffusion virtuelle, des tirages papier en quantités limitées sont rendus possibles par l’évolution des techniques de publishing : certains éditeurs proposent d’ores et déjà des impressions en séries extrêmement limitées, voire à la demande – en fait le livre part en impression seulement après avoir été commandé.
Un modèle mixte – PDF téléchargeable gratuit/papier expédié payant à coûts réduits – constitue une alternative intéressante à un modèle purement virtuel : certains lecteurs, réticents à ingurgiter un lourd pavé sur écran, seront heureux de prolonger de façon plus classique un ouvrage feuilleté électroniquement.
La publication papier à façon peut se déconnecter de la fonction d’édition : un même imprimeur/routeur peut sous traiter cette tâche industrielle pour plusieurs maisons d’édition en ligne, assurant ainsi une sorte de back office ; dès lors, ces dernières peuvent aisément se constituer sans nécessaire apport de capitaux – voire fonctionner sur le seul bénévolat associatif.
Dès lors, n’importe qui – n’importe quel groupe – peut s’instituer éditeur, se constituer en maison d’édition : je militerais alors volontiers pour un système collaboratif par cooptation : deux ou trois auteurs se regroupant pour créer une telle maison virtuelle à l’occasion de la publication du dernier ouvrage de l’un d’entre eux… Suivront ensuite ceux des autres membres de la coopérative, et le tour est joué : aussi simple, ou presque, de lancer un blog sur Internet.
Pas de comité de lecture : la coopérative s’élargit par cooptation… structure et fonctionnement simplissime !
Evidemment, Web 2.0 permettra de créer le buzz… et comme ces auteurs Web 2.0 sont aussi des bloggers – confirmés, sinon d’influence, sinon, ils n’auraient jamais réussi à accoucher d’un livre – leurs réseaux vont rapidement propager l’information… et c’est tout ! C’est Web 2.0 : si le livre est bon, il aura une chance proportionnelle à sa qualité !
Quelques structures associatives plus établies pourraient fédérer autour d’elles plusieurs de ces microstructures virtuelles, leur conférant une plus grande visibilité – sans nécessairement cautionner les contenus : elles n’auraient pas à se substituer à leur direction littéraire.
Finalement, un schéma aussi souple que Web 2.0.
La redaction de Marketing is dead, mon prochain livre, avance très doucement, mais qui va piano… je suis prêt à le mettre au pot d’une telle démarche.
Et si quelqu’un est assez fou pour tenter l’expérience, ou simplement a envie de continuer le débat sur le thème, welcome on board !
18:45 Publié dans Web 2.0 | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : édition, Web 2.0, livre, virtuel, marketing, coopérative | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/04/2007
Chronique d’une mort annoncée : j’avais raison !
 Sous le titre : Chronique d’une mort annoncée, j’écrivais dans ces colonnes, le 8 Septembre 2006 : « Je souhaiterais évoquer le cas d’Apple – et plus particulièrement de son offre musicale fondée sur le trinôme : marque / produit / services ».*
Sous le titre : Chronique d’une mort annoncée, j’écrivais dans ces colonnes, le 8 Septembre 2006 : « Je souhaiterais évoquer le cas d’Apple – et plus particulièrement de son offre musicale fondée sur le trinôme : marque / produit / services ».*
Et de pointer du doigt parmi les défauts gravissime dans la cuirasse de la firme de Compertino le verrouillage de l’ensemble « par un standard privatif, l’Advanced Audio Coding : les fichiers iTunes ne sont lisibles que sur les baladeurs… iPod ».*
Vous allez me dire : Apple ne s’est jamais si bien porté… et c’est vrai !
Sauf que Steve Job, le pourfendeur absolu de l’interopérabilité – en bon français, la possibilité de lire sur tout baladeur les fichiers en provenance de n’importe quelle source ;
Steve Job qui vilipendait la loi Dadvsi – qui instaurait timidement cette interopérabilité – parce qu’allait faire « s'effondrer les ventes de musique en ligne juste au moment ou les alternatives légales commençaient à séduire les clients »* ;
Steve Job qui parlait de « piratage sponsorisé par l'Etat »* ;
Steve Job donc, vient de passer avec armes et bagages dans le camp adverse… et de signer un accord historique avec le président de EMI, Eric Nicoli, en acceptant de vendre sans verrou aucun l’intégralité du catalogue de la maison de disque, de Norah Jones à Gorillaz en passant par Robbie Williams.
Retourner sa veste et avaler des couleuvres est certainement moins dramatique que mourir au front : mais, in fine, j’avais raison : la position de Steve Job était intenable et suicidaire.
Au delà de l’anecdote – l’honneur et les affaires n’ont jamais fait bon ménage -, cet accord me semble ô combien historique : il marque une nouvelle et capitale étape vers la disparition totale et définitive des DRM – les fameux Digital Rights Management – censés protégés les contenus numériques contre le piratage… et qui ne font que générer le piratage.
Ils génèrent le piratage parce que les hackers les cassent plus vite que les firmes les mettent au point… et que dès lors, il est plus aisé de récupérer un fichier mp3 sur le P2P que l’acheter sur iTunes.
Mais surtout, les DRM apparaissent comme l’ultime combat d’arrière-garde de professions qui n’ont pas compris que le monde évoluaient bien plus vite qu’elles ne le réalisaient – et surtout qu’elles n’étaient capables de s’adapter.
Car il n’y a pas que la musique qui est concernée : le livre, et plus particulièrement l’édition scientifique et professionnelle, entre aujourd’hui en pleine zone de turbulence. Et d’ailleurs, les DRM se sont invités en guest stars au dernier Salon du Livre !
Normal : les auteurs se trouvent de plus en plus confrontés à des éditeurs incompétents, qui ne s’intéressent qu’aux pré-ventes sans trop se soucier des contenus… et qui oublient que bien des auteurs préfèreraient voir leur pensée circuler gratuitement plutôt que de rester sans promotion en fond de rayons.
Un peu comme bien des artistes qui diffusent gratuitement leur musique sur Internet pour attirer les jeunes dans les salles de concert. Un peu comme les Artic Monkeys et Clap Your Hands Say Yeah : si ces noms ne vous disent rien, jetez un œil sur ma note du 13 Mai 2006.
* Voir ma note du 08.09.2006