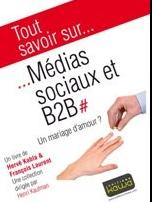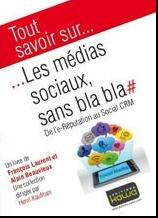07/07/2006
Notre cerveau reptilien
 Récemment relevé dans l’édition on line de Sciences et Avenir* :
Récemment relevé dans l’édition on line de Sciences et Avenir* :
« L’équipe de Melissa Bateson, de l’université de Newcastle a mené une série de tests dans une salle de l’université où une cinquantaine de personnes viennent quotidiennement prendre leur thé ou leur café. Chacun doit payer sa consommation en mettant la monnaie dans un tronc commun, appelé très justement "honesty box" en anglais. Sans avertir personne, Bateson et ses collègues ont imprimé chaque semaine une feuille de tarifs avec une image en haut de la feuille : soit des fleurs, soit des yeux regardant directement l’observateur.
« Les chercheurs ont constaté que, les semaines où figuraient les yeux, les consommateurs payaient en moyenne 2,76 fois plus pour leurs boissons que lorsqu’il y avait des fleurs. Ils en déduisent que la simple sensation d’être vus les poussait à un comportement plus généreux ».**
…ou plus simplement à ne pas tricher, en négligeant de payer son dû de temps à autre : n’est-ce pas là même, la raison d’être d’une boîte d’honnêteté ?
Sans doute, mais comment ça marche ?
Pour bien comprendre les mécanismes en œuvre, il faut se souvenir qu’en plus d’une mémoire à court terme, et d’une mémoire à long terme, d’un inconscient Freudien et d’un inconscient cognitif – ce dernier totalement inaccessible –, nous possédons… trois cerveaux !
Le cerveau reptilien – le plus ancien et le plus profond –, que nous partageons avec les lézards, et qui gère instincts et réflexes : en présence d’une menace, notre rythme cardiaque s’accélère.
Le cerveau – ou système – limbique, que nous partageons avec le rat, et qui contrôle nos sentiments, nos humeurs, nos comportements.
Le cerveau cortical – ou cortex cérébral –, déjà présent chez certains mammifères supérieurs : c’est lui qui nous permet de prendre des décisions raisonnées, après avoir évalué bénéfices et inconvénients d’une action.
Le cas qui nous occupe concerne notre cerveau reptilien : de même que la crainte d’une mauvaise rencontre nocturne augmente notre débit sanguin, le regard posé sur nous limite nos comportements malhonnêtes : ce ne sont que réflexes, dans un cas comme dans l’autre.
Inutile d’espérer intégrer de tels résultats au niveau publicitaire : nous nous situons nécessairement ici dans le champ de l’immédiateté, sans effet latent ou rémanent.
Par contre, le contrôle des effets du cerveau reptilien sur l’efficacité de la communication sur le point de vente est capital : si des yeux bien placés peuvent sans doute éviter des dégradations en distribution automatique, d’autres peuvent gêner un chaland flâneur et l’amener à quitter trop rapidement le rayon.
Le cerveau limbique n’est pas à ignorer non plus : le serveur de café qui frôle adroitement le bras des consommateurs recevra de plus conséquents pourboires que son collègue stylé, parce qu’il aura su établir un premier contact émotionnel ! Si, si : je n’ai pas conservé les références de l’expérience, mais je suis preneur si l’un d’entre vous peut me les envoyer.
Notre – nos – cerveau nous réserve bien des surprises, et plus les budgets se déplaceront de la communication médiate – publicité – à la communication immédiate – sur le point de vente –, plus nous devrons apprendre à maîtriser cerveaux reptilien et limbique.
Il en va de même pour les médias interactifs : quand tout se situe à portée de clic, nos instincts peuvent rapidement reprendre le dessus ; et ce que jadis on appelait les ficelles du métier tombe aujourd’hui dans le champ – quand même plus noble – des sciences cognitives.
Le résultat restant le même.
* http://sciences.nouvelobs.com
** Travaux publiés dans Biology Letters, revue de la Royal Society : http://www.journals.royalsoc.ac.uk
18:32 Publié dans Sciences Cognitives | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/07/2006
A l’écran oui, mais pas sans mon image !
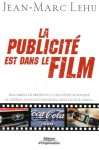 Inaugurant la rubrique Les copains d'abord, un premier papier de Jean-marc Lehu nous invite à réfléchir sur le placement de produits.
Inaugurant la rubrique Les copains d'abord, un premier papier de Jean-marc Lehu nous invite à réfléchir sur le placement de produits.
A l’heure où d’aucuns s’interrogent à juste titre sur la signification de l’image de marque, sur sa place et son rôle dans notre mémoire, le phénomène du branded entertainment – communication de la marque dans un contexte de divertissement – prend de l’essor. Logique après tout, l’audience des media classiques est de pus en plus fragmentée et dispersée. Il importe donc de trouver d’autres vecteurs pour garder – sinon renouer – le contact avec le consommateur.
Dans le vaste arsenal du branded entertainment, le placement de produits et de marques dans les films tient bonne place. Et si la technique est quasi séculaire, elle a connu ces derniers mois un essor extraordinaire, notamment aux États-Unis.
Au grand dam des financiers, il ne s’agit pas de la dernière technique de communication à la mode dont le succès assuré est immédiatement perceptible de manière sonnante et trébuchante, dans les comptes à courte terme de l’entreprise pratiquante. L’objectif du placement de produits est d’abord et avant tout un objectif de notoriété. Faire connaître la marque, ou faire en sorte qu’elle ne disparaisse pas de l’ensemble évoqué du consommateur, en rappelant son existence autant que faire se peut.
Mais le placement de produits ou de marques peut également poursuivre un objectif parallèle d’entretien ou d’amélioration de l’image de la marque. Pour cela, il est généralement nécessaire de passer du principe du simple placement, à celui de l’intégration de marque.
En d’autres termes, de tout mettre en œuvre pour offrir à la marque un vrai rôle dans le film, et plus simplement de plaquer son logo dans l’arrière plan d’une scène. Cette démarche valorisante est déjà poursuivie depuis quelques années outre-atlantique, et de nombreux agents professionnels du placement, réunis au sein de l’ERMA*, œuvrent déjà en ce sens.
De manière exceptionnelle et surprenante… l’Europe, et plus particulièrement la France, sont quelque peu à la traîne. Il existe bien de rares professionnels tels que Film Media Consultant ou Marques & Films, dont l’expérience réelle est déjà mise à profit par les marques.
Mais ce sont là deux exceptions. Dans de nombreux cas, la gestion de l’apparition des marques ou de leurs produits demeure très artisanale, quand elle n’est pas pénalisée par un cadre légal, dont la Commission et le Parlement européens n’ont que trop tardé à s’inquiéter de l’évolution, malgré les propositions pertinentes de la Commissaire Reding.
Pourtant, un film peut être un formidable véhicule culturel pour l’image de la marque. Qu’il s’agisse du contexte d’utilisation de la marque, de l’acteur qui cite telle ou telle marque, de la nature de l’utilisation de tel ou tel produit… le branded entertainment peut devenir un véritable vecteur d’image.
Lorsque récemment, Porsche est courtisée dans Cars de John Lasseter, que le Ritz est LE palace parisien retenu pour Da Vinci Code (Ron Howard), que The North Face protège du froid les héros de Antartica, Prisonniers du froid (Frank Marshall) ou encore que Bed Bath and Beyond (Michael Newman), présente dans Click, paraît être l’enseigne dans laquelle l’acteur Adam Sandler semble réellement pouvoir tout trouver, les marques concernées sont valorisées.
Comme tout vecteur de communication, le placement de produits ou de marques doit faire l’objet d’une approche stratégique, afin de préserver et valoriser l’image de la marque. A fortiori, parce qu’un film est multi diffusé – salles, dvd, circuits spécialisés, télévision payante puis gratuite, téléchargement… – et qu’il peut de surcroît être rediffusé à de nombreuses reprises dans le temps.
Certaines associations sont donc à éviter comme la peste. D’autres en revanche, sont à rechercher pour la cohérence avec le positionnement et l’identité de la marque, quitte à payer cher pour en obtenir l’exclusivité et les meilleures conditions possible d’apparition à l’écran. Ce n’est pas parce que la publicité sera dans le film, qu’on la verra et qu’on l’appréciera…
12:06 Publié dans Les copains d'abord | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |