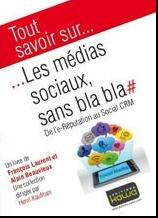23/10/2011
Les marques ont-elles encore une raison d'être dans l'assurance et les services financiers ?
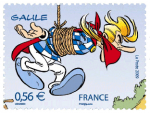 La question peut paraître un peu provocatrice ... mais l'est-elle tant que cela ? Après la crise des subprimes de l'été 2007 et toutes les secousses qui ont bouleversé la planète financière après, la confiance dans les marques semble plutôt en berne.
La question peut paraître un peu provocatrice ... mais l'est-elle tant que cela ? Après la crise des subprimes de l'été 2007 et toutes les secousses qui ont bouleversé la planète financière après, la confiance dans les marques semble plutôt en berne.
D'ailleurs, il suffit de jeter un œil sur les conversations en ligne : les Français ne cherchent plus vraiment « un bon assureur », juste un « assureur pas cher ».
Dans ce cas, à quoi bon développer de coûteuses politiques de marque et ne pas se contenter de pratiquer de manière très opportuniste les prix les plus attractifs ?
Mais qu’est-ce qu’une marque ?
Toutefois, avant de jeter aux orties les règles traditionnelles du marketing pour maximiser le ROI, peut-être serait bon de se poser la question : qu’est-ce qu’une marque ?
Une fiction, un substitut – à un créateur, un fabricant, un artisan –, et une abstraction : c’est pour cela que l’on parle tant d’ADN, de personnalité de marque – juste pour oublier qu’une marque n’est pas, ne sera jamais, humaine.
Pourquoi et comment sont-elles apparues ?
On renverra à Procter & Gamble et à leur mythique savon Ivory, « un savon blanc peu coûteux d’une haute qualité égale à celle des savons importés de Castille », comme le rappelle encore le site du groupe : comment convaincre des millions d’américains de l’acheter ?
Par la publicité – 11 000 $ dans un magazine hebdomadaire.
Les marques se sont développées le jour où s’est définitivement rompue la relation entre producteurs et consommateurs, entre fabricants et clients ; où le vendeur ne pouvait plus convaincre son acheteur dans le cadre étroit de sa boutique : « Ceci vous donnera toute satisfaction ».
La publicité se développera avec des annonces vantant des bénéfices, et un progrès, très concrets : ceux du « Avec Génie, je ne fais plus bouillir », des premiers réfrigérateurs, des premiers hypermarchés regorgeant de produits quasi magiques.
Ce sera dans le domaine bancaire, cette annonce expliquant que la « Carte Bleue permet de retirer de l’argent dans 9000 agences de banque » ; et cette autre où la BNP reconnaît : « Pour parler franchement, votre argent m’intéresse ».
De même qu’à la marque Génie s’associe un bénéfice extrêmement tangible (l’époque n’était pas encore loin des lessiveuses débordant sur les gazinières), Carte Bleue devient synonyme d’argent aisément disponible et la BNP de banque transparente et efficace – bien qu’un peu cynique !
Quand la communication prime sur son objet
Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes – ou du moins jusqu’à la fin des Trente Glorieuses).
Jusqu’à ce que les publicitaires, découvrant qu’ils n’ont plus rien à dire des produits dont les annonceurs leur confient la destinée, se décident à qualifier … les acheteurs de ces produits.
Avant, on achetait une DS pour le plaisir, voire ce que Barthes nommait « une gourmandise de la conduite » ! A partir des années 70, les cadres se rueront sur les BMW pour affirmer leur réussite sociale, comme le constatera Baudrillard : « Les objets […] ne "désignent" non plus le monde, mais l'être et le rang social de leur détenteur ».
Ce nouvel âge, qu’avec l’auteur du système des objets ont pourra qualifier de postmoderniste, sera l’âge d’une consommation désabusé, où le progrès ne sert plus vraiment les individus, mais leur permet juste de se différencier les uns des autres ; où on n’achète plus un téléviseur Sony pour son image mais pour son prix … élevé !
Le postmodernisme sera l’époque où tous les produits se ressemblent – Clio, Fiesta, Corsa, … : comment les différencier ? – et où des consommateurs blasés se rassurent en payant plus cher.
Jusqu’à la caricature quand Séguéla déclare : "Si on n'a pas de Rolex à 50 ans, on a raté sa vie".
Dans le domaine financier, à l’annonce Carte Bleue précédente succédera par exemple une publicité American Express titrée « Des clients hors du commun », présentant un couple très BCBG dans un restaurant étoilé. Le postmodernisme n’empêche pas un certain humour décale, comme en témoigne cette autre annonce pour Barclays ironisant : « Chaque année en France, l’ISF frappe des centaines de foyers dans l’indifférence générale ».
Le marketing développera alors ses programmes de fidélisation, plus élitistes les uns que les autres, avec ses cartes Gold et autres Premium ; et mutatis mutandis, mêmes les ménagères y auront droit dans leurs hypermarchés habituels, avec caisses rapides réservées !
Ironie du sort, tout ce marketing et toute cette communication plus fondés sur le « paraître » et « l’avoir » que sur « l’être » – et fondamentalement sur l’argent et la possession – se développent dans un période où le pouvoir d’achat marque le pas et le chômage explose : les « Restos du Cœur » ouvrent leurs portes en 1985.
Un décalage apparaît doucement entre un discours publicitaire élitiste et une réalité sociale qui s’assombrit d’année en année : la publicité ne propose plus un modèle aspirationnel (= « Je ne veux pas rater la vie, donc je me fixe pour objectif d’avoir ma Rolex à 50 ans ») ; elle se mue juste en machine à rêver (= « Je sais bien que je n’achèterai jamais la BMW dont je regarde les spots avec plaisir et envie »).
Le postmodernisme aurait pu durer longtemps – aussi longtemps que les publicitaires verrouillaient la communication marchande : la puissance du média télévisuel les y aidait grandement … sauf que le jour où Le Lay déclarait vendre à Coca-Cola « du temps de cerveau humain disponible », le tonneau des Danaïdes s’était réellement mis à fuir de partout.
Marques : nouvelle société et nouveau futur
Comme l’annonçaient dès 1999 les rédacteurs du Cluetrain Manifesto, « les marchés sont des conversations » : à côté du verticalisme de la publicité médias, naissait une communication citoyenne, horizontale, entre pairs.
Le mouvement s’initia modestement sur les premiers forums de discussion, puis s’amplifia avec l’apparition des blogs et du Web 2.0, puis explosa sur les réseaux sociaux et les sites de micro-blogging, Facebook et Twitter en tête.
Et les gens se sont tranquillement mis à discuter des produits et des marques qu’ils achetaient, non plus en en termes de signes, mais de réels bénéfices – et cela tombait bien, depuis un quart de siècle que leur pouvoir d’achat s’érodait (les revenus salariaux n’ont pas progressé en France depuis 1980 - Source : Insee).
Dès lors, ils allaient distinguer les vrais progrès des faux … car bizarrement avec Internet, fixe ou mobile, notre société s’était remise à avancer : alors que les publicitaires s’évertuent toujours à parler de signes, les consommateurs parlent d’usages ; il semblerait même que certains retrouvent un certain plaisir à consommer – utilement, s’entend – comme ce fut le cas de leurs parents et grands parents dans la France de l’après guerre.
Retour vers le modernisme ?
Paradoxe : alors que de nombreuses sont les marques qui se proclament haut et fort leur légitimité, alors qu’elles ne proposent aucun contrat réel, ce sont souvent celles à qui on dénie l’appellation – les no names, les sans marques – qui renouent avec le contrat original d’un juste rapport qualité prix.
Revenons à la question initiale : les marques ont-elles encore une raison d'être dans l'assurance et les services financiers ?
Oui si elles répondent aux attentes les plus actuelles des Français : leur apporter des avantages concrets, simples, différenciants … et surtout bien réels !
Evidemment, aucun intérêt si elles ne communiquent que sur de la cosmétique, si elles cherchent à capter le consommateur en mettant en avant des bénéfices que, peu ou prou, leurs confrères mais néanmoins concurrents, promeuvent … si elles imaginent qu’il suffit de raconter de belles histoires pour devenir crédibles !
Donc n’ont d’avenir que si elles montrent une réelle capacité à innover : là, elles retrouveront une véritable légitimité – en assurance comme dans bien d’autres secteurs, d’ailleurs !
Certes, il est plus facile d’innover quand on s’appelle Apple – mais ce n’est pas parce qu’on se nomme autrement et qu’on ne vend pas du High Tech qu’il faut baisser les bras … même si c’est ce que font bien des acteurs du secteur, à en croire leurs clients.
Car quand on demande à ces derniers quels sont les secteurs qu’ils jugent avoir été parmi les plus innovants au cours des 10 dernières années (réponses multiples, plusieurs secteurs pouvant être cités), 1 sur 10 seulement évoquent les assureurs, bon derniers avec les services hôteliers et juste derrière l’habillement.
La réponse à la question initiale semble fortement dépendre de la capacité du secteur à innover – réellement innover ; on peut considérer cette condition pour une gigantesque opportunité pour les marques qui sauront le faire, et le prouver.
22:52 Publié dans Marques | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |